Les
crimes des Conseils de guerre
(Le texte semble daté de 1925)
Les
quatre caporaux de Suippes
En février 1915,
le 336e régiment d'infanterie avait pris part
aux violents combats de Perthes. En mars, on le retrouve néanmoins en première ligne
au moulin de Souain.
7 mars 1915
Le 7, après une préparation d'artillerie
insuffisante – suivant le témoignage du commandant Jadé,
ancien officier du 336e et actuellement député du
Finistère (en 1925) – on lance en avant la 24e compagnie, dont les effectifs
sont très réduits.
Elle est aussitôt rejetée dans ses tranchées avec
des pertes sérieuses.
 Cet
échec ne décourage pas à l'état-major.
Cet
échec ne décourage pas à l'état-major.
Deux heures plus tard, après une brève canonnade,
on fait sortir la 21e compagnie, commandée par le commandant Dubois.
Celle-ci est à son tour également repoussée.
Dans la nuit, le capitaine Jadé,
de la 18e compagnie, reçoit l'ordre d'attaquer par surprise à 4h30 du matin les
tranchées ennemies, qui, la veille, n'ont pu être prises.
Mais la compagnie de première ligne qui doit
relever la 18e n'a pas été prévenue à temps. Un certain flottement se produit
au moment de son arrivée, et le capitaine Jadé, qui
avait donné l'ordre d'attaque pour 5 heures est obligé de le reporter à 5 h 30.
À 5 heures cependant, l'artillerie française
commence à tirer contre les tranchées ennemies.
À 5 h 30, à l'instant où la 18e compagnie essaye de
sortir de sa tranchée, les compagnies voisines, ignorant le coup de main qui
allait être tenté, lancent des fusées.
Dès lors, l'opinion du capitaine Jadé est faite. Il recommande à ses hommes de ne pas
bouger, va trouver à quelque distance en arrière le commandant de bataillon.
« Vous m'avez donné l'ordre d'attaquer par
surprise, lui dit-il, j'estime que la surprise était en effet la
condition de l'attaque. Attaquer maintenant n'est plus possible. Ce serait
faire tuer peut-être 50 hommes de ma compagnie. J'ai pris sur moi de ne pas
sortir.
Mais comme je ne veux pas que vous puissiez
considérer cela comme une lâcheté, je suis prêt, si vous me l'ordonnez, à
monter sur le tremplin. »
Le commandant se rend aux raisons du capitaine Jadé.
Il n'insiste pas.
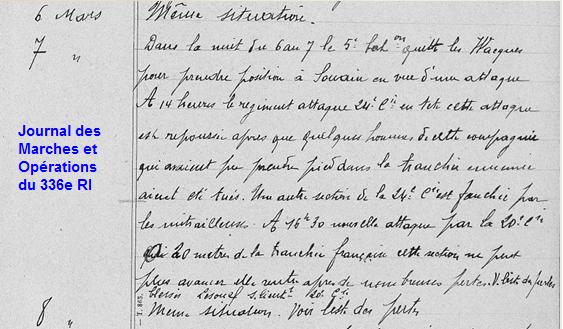
9 mars 1915
Le surlendemain, 9 mars, l'ordre est donné à une
autre compagnie, la 21e, de se préparer à sortir.
Quant à la 18e compagnie, elle devra suivre la
première vague d'assaut, se placer entre la tranchée de départ et les tranchées
allemandes éventuellement prises, puis, là, AU MILIEU DE LA PLAINE, AU GRAND JOUR,
commencer des travaux, amorcer des boyaux vers l'avant et l'arrière.
La 21e compagnie quitte les tranchées de réserve à
4 h du soir pour gagner les tranchées de départ.
Pendant de longues heures, les hommes ont sous les
yeux les cadavres de leurs camarades tombés dans les attaques précédentes, les
uns deux jours plus tôt, les autres il y a six mois. Nul spectacle n'est plus
démoralisant.
Lorsque vient l'heure d'une sortie que les
combattants savent d'avance condamnée à l'insuccès, des protestations
s'élèvent.
« Nous
préférons être fusillés, disent-ils, mais enterrés que de rester là-bas à
pourrir sur le bled. Au moins nous aurons sauvé du massacre les camarades de la
22e, qui doivent marcher derrière nous. »
Le capitaine pour les entraîner crie : en avant
!
Il est suivi seulement de l'aspirant Germain et de quelques
sous-officiers qui, d'ailleurs, ne tardent pas, sous la violence du feu ennemi,
à revenir dans la tranchée.
À l'arrière, où l'on s'est rendu compte de ce qui
se passe, mais où l'on ne veut pas se rendre compte de l'impossibilité où se
trouvent les malheureux soldats de faire mieux, le général commandant la 60e
division donne l'ordre à l'artillerie de tirer sur la tranchée, de tuer tous
ceux qui ont obéi et ceux qui n'ont pas obéi.
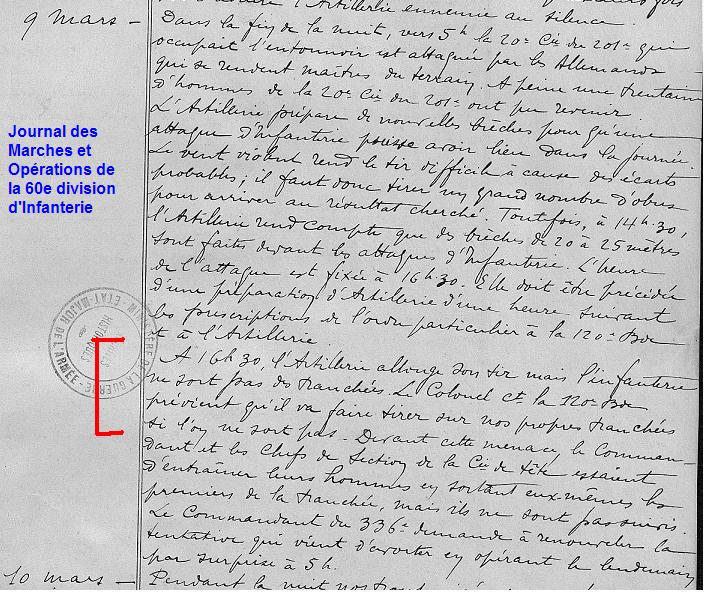
Cet ordre sauvage, le colonel Bérubé,
commandant l'artillerie divisionnaire, refuse de l'exécuter.
« Que le
général de division le signe » répond-t-il à l'officier qui est venu le
lui transmettre de vive voix.
Le général n'a pas le courage de prendre cette
responsabilité, mais il fait prévenir que l'attaque devra être reprise par la
21e compagnie.
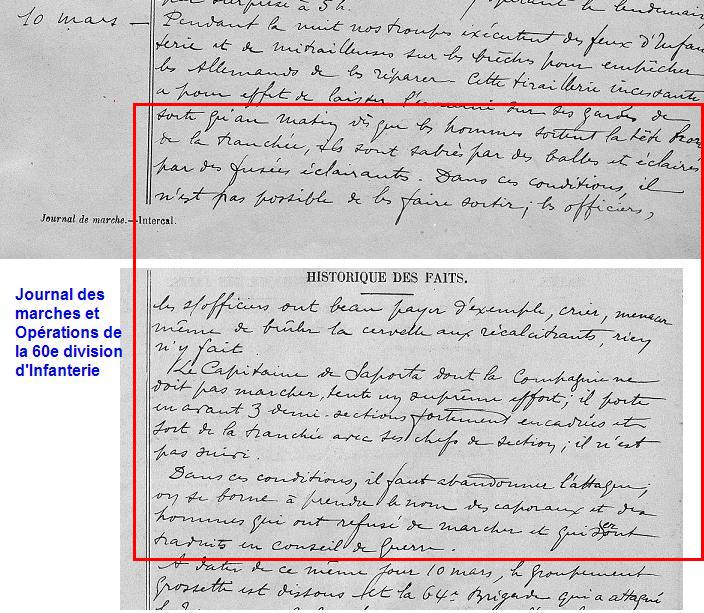
Après quoi, prenant le nom d'un caporal et de
quatre soldats par section, on leur demande de se porter en avant – il fait
encore jour – pour couper les fils de fer barbelés.
Les caporaux Maupas, Girard, Lefoulon
et Lechat, se trouvent au nombre des victimes ainsi
sacrifiées, car c'est à une mort inutile et certaine qu'on les envoie. Toute la
compagnie, qui s'en rend compte, est en proie à une indicible émotion. Lechat avait été volontaire la veille pour une mission
périlleuse.
Plusieurs de ses camarades, révoltés de l'injustice
qui lui est faite, s'offrent pour le remplacer.
Vain héroïsme.
Les quatre caporaux et leurs hommes se
révoltent-ils ? Point ; ils essayent d'obéir ; ils se portent en avant. Mais
les fils de fer sont à 150 mètres. L'impossibilité d'y arriver est manifeste.
Ils se terrent dans des trous d'obus.
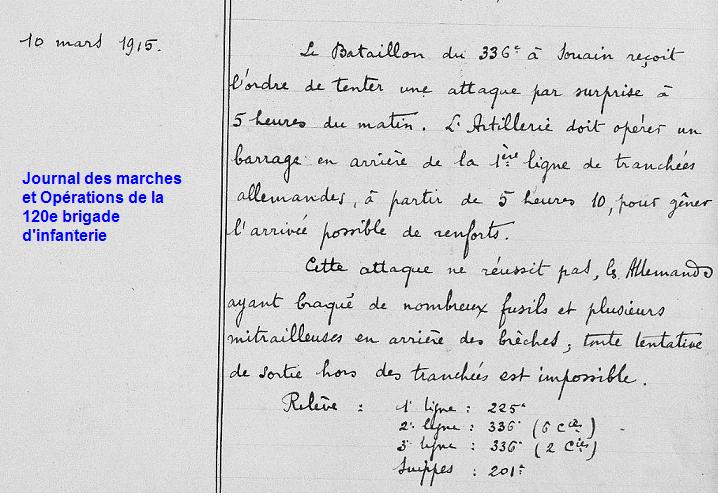
L'aspirant Germain court jusqu'à l'endroit où se
trouvent blottis les quatre hommes et le caporal de sa section. Il les exhorte
à un effort dernier. Mais ce ne sont plus, suivant son expression même, que de
"véritables loques". Ils ont atteint la limite de l'endurance
humaine. Ils ne peuvent bouger.
À la nuit, caporaux et soldats regagnent la
tranchée.
10 mars 1915
Dans l'après-midi du 10 mars, la 21e compagnie est
relevée et dirigée sur Suippes, où, aussitôt, on incarcère les caporaux Maupas,
Girard, Lefoulon, Lechat et
une trentaine de soldats, en les informant qu'ils sont inculpés de refus
d'obéissance devant l'ennemi.
Le régiment est consterné.
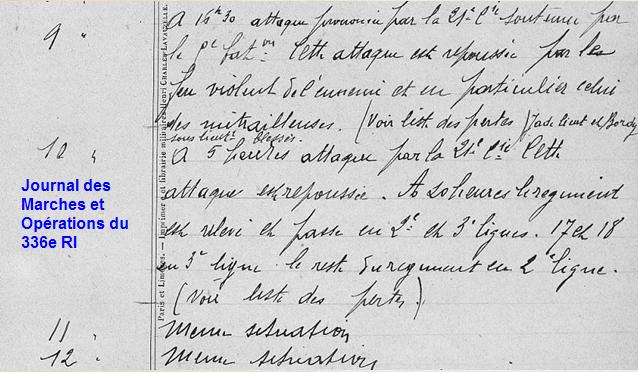
------
16 mars 1915
Le 16, la Cour martiale se réunit. Seul, le colonel
président est un combattant. Ses assesseurs, bien qu’officiers de carrière,
appartiennent à des services de l'arrière.
Quelques officiers ont été appelés à témoigner.
Mais systématiquement, on a refusé d'entendre ceux qui ont demandé à déposer.
Le commandant du bataillon auquel appartient la 21e
compagnie plaide chaleureusement la cause des accusés.
Il est à chaque instant interrompu. Il est injurié.
Peu s'en faut qu'on ne le rende responsable.
Un témoin, avocat d'un barreau de province, qui,
officier de complément au 336e, assistait à cette hideuse comédie judiciaire, a
écrit avant de mourir glorieusement sur le champ de bataille :
"Ces hommes, pris presque au hasard, furent
simplement traduits en Conseil de Guerre. Trente-deux furent acquittés sur la
déclaration d'un adjudant, d'après laquelle il ne croyait pas qu'ils aient
entendu l'ordre de : en avant ! Et quatre furent condamnés à mort (les
caporaux).
L'adjudant a été pris en grippe par le général de
division qui a interdit formellement une proposition faite précisément pour
lui, paraît-il, pour le grade de sous lieutenant.
Les témoins furent pris parmi les chefs qui avaient
passé les trois jours dans les caves. Mais on s'est bien gardé de faire
appeler les quatre seuls officiers dont j'étais,
qui avaient passé les trois jours auprès des hommes, et qui seuls auraient pu
dire la vérité. L'affaire a été truquée d'un bout à l'autre.
Je le dis en toute conscience : LES QUATRE
CAPORAUX SONT MORTS ASSASSINÉS
Ce témoignage n'est pas unique.
Le capitaine R., qui assistait à l'audience
présidée – il faut retenir ce nom pour l'exécration des honnêtes gens – par le
colonel MARTHENET, en fait le récit suivant :
« Je me rendis à la séance et j'entendis déposer le
capitaine Equilbey qui commandait un bataillon aux
336e. Le capitaine Equilbey exposait au Conseil
combien l'attaque se présentait mal et faisait valoir les difficultés
d'exécution. Il faisait sa déposition en homme loyal et droit, et avec d'autant
plus d'indépendance que le bataillon incriminé n'était pas le sien.
Je remarquai que, presque à chaque mot, il était
interrompu par le président du Conseil de guerre et qu'il avait grand peine à faire sa déposition.
Je ne voulus pas rester plus longtemps dans cette salle, où les témoins avaient
tant de difficultés à déposer, et sortis. »
M.L. dit à son tour :
« C'est en conversant avec le capitaine Equilbey, de l'état-major du régiment, que j'appris la mise
en accusation. Je ne pus, à mon grand regret, assister à l'audience du Conseil
de guerre où s'était rendu le capitaine Equilbey pour
défendre la cause du caporal Maupas, qu'il connaissait particulièrement et
estimait beaucoup.
C'est en termes indignés et douloureusement sympathiques
qu'il m'apprit la fatale nouvelle. Rien n'avait pu sauver Maupas et ses trois
malheureux compagnons, ni la défense du capitaine Equilbey,
ni la déclaration du colonel Bérubé, commandant
l'artillerie divisionnaire, dont la conscience se révoltait à l'idée de
s'associer à une infamie et qui s'écria : ce ne sont pas là les vrais
coupables. Il faut chercher plus haut. »
(Par contre, il y eut un réquisitoire impitoyable,
très favorablement écouté. Au sujet du lieutenant Morvan, l'accusateur initial,
M.L. s'exprime ainsi : « le lieutenant Morvan, l'accusateur de Maupas,
poursuivi par la vindicte de ses camarades, s'enferma dans sa chambre pour y
cacher sa honte »)
M.M. dépose :
« il m'a été affirmé que le colonel Bérubé, commandant le 7e R.A.C., aurait dit au général Reveilhac, à l'issue du Conseil de guerre : C'EST UN
ASSASSINAT. Cette parole fut la cause de son limogeage immédiat. Le témoignage
de ce colonel, s'il vit encore, serait précieux. »
M.Q. dit enfin :
« J'assistai à une partie des débats : j'en sortis
avec l'impression que tous les juges, presque tous ignorants de ce que
pouvait être une tranchée de première ligne, OBÉISSAIENT À UN ORDRE EN
CONDAMNANT QUATRE CAPORAUX À LA PEINE DE MORT. »
À la vérité, quelques instants après son impitoyable
arrêt, le Conseil de guerre, pour couvrir sa responsabilité, signa
un recours en grâce. Mais il ne fut pas suivi d'effet.
(À Suippes où eut lieu l'exécution, on dit que
celle-ci fut pressée par le général Reveilhac qui
craignait de voir arriver la grâce. "En effet, l'ordre de surseoir à
l’exécution arriva quelques instants après que les quatre malheureux caporaux
fussent tombés" -- lettre de M.Ch.F. à la Ligue
des Droits de l'homme.)
L'exécution était fixée au lendemain.
------
Le 10 mars, avant sa comparution devant la Cour
martiale, le caporal Maupas avait adressé à sa femme la lettre suivante, dont
nous voulons que l'on dise si elle mérite mépris ou respect :
«
Me voilà réveillé encore une fois, ayant plutôt l'air d'un mort que d'un
vivant. Mon coeur déborde, tu sais; je ne me sens pas la force de réagir. C'est
inutile, c'est impossible.
J'ai
pourtant reçu hier les deux boîtes que tu m'as envoyées, contenant sardines,
beurre, réglisse, figues, pommes et mon beau petit sac, et les belles cartes, j'étais
heureux ; mais je me suis tourné vers la muraille et de grosses gouttes,
grosses comme mon amour pour les miens, ont roulé, abondantes et bien amères.
Dans
ces moments où je songe à tout ce qui se passe d'horrible et d'injuste autour
de moi, sans avoir une ombre d'espoir, eh bien, tu sais, je suis entièrement
déprimé.
Je
n'ai plus la force ni de vouloir, ni d'espérer quoi que ce soit.
Je
ne vais pas continuer, ma pauvre Blanche, je ne vais pas continuer, je te
ferais de la peine et je pleurerais encore.
Aujourd'hui
je vais savoir le résultat de l'affaire.
Comme
c'est triste. Comme c'est pénible. Mais je n'ai rien à me reprocher, je n'ai ni
volé, ni tué ; je n'ai sali ni l'honneur, ni la réputation de personne. Je puis
marcher la tête haute.
Ne
t'en tracasse pas, ma petite Blanchette. Il y a bien assez de moi à penser à
ces tristes choses. C'est pénible, attendu qu'à mon âge, ni dans la vie civile,
ni dans la vie militaire, je n'ai dérogé à mon devoir.
Pour
quiconque n'a pas d'amour propre, ce n'est rien, absolument rien, moins que
rien.
Moi
qui ai du caractère, qui m'abats, qui me fait du mauvais sang pour rien, eh
bien, tu sais ma bonne petite, j'en ai gros sur le coeur.
Il
me semblait pourtant que depuis mon enfance, j'avais eu assez de malheur pour
espérer quelques bons jours. C'est ça la vie ? Eh bien ce n'est pas grand-chose
! Que de gens comme moi ont un foyer et ne sont plus ! Des petits-enfants
appelleront souvent leur papa, une femme adorée qui se rappellera un mari
dévoué ! C'est bien quand je songe à ces tristes choses !
Allons
courage ! Courage, mon petit bonhomme ! Soutenons-nous ! Aimons-nous !
J'embrasse
ton beau petit sac, ta bonne lettre, ta carte, tes cheveux. Tout cela est là
dans un petit coin de mon sac. Je l'ouvre souvent ce vieux sac pour y voir mes
objets chers qui sont une partie de toi et de mon petit Jean. Pauvre petite !
Allons,
courage mon petit soldat !
Je
me serre bien dur contre toi !
Ne
me quitte pas et veille bien sur moi !
Embrasse
bien fort ma Jeannette !
Que
je t'aime mon Dieu ! Et que je pleure ! »
Cette lettre, d'une si émouvante simplicité, est-ce
la lettre d'un lâche ?
------
Le capitaine Jean Jadé,
auquel il a été fait allusion au cours de ce tragique récit, a précisé devant
la Chambre des Députés les conditions dans lesquelles l'ordre d'attaque avait été donné et les condamnations
prononcées :
« Le 7 mars, dit-il, on donne l'ordre à la 21e
compagnie de prendre la première ligne et de se préparer à sortir.
Ici commence le drame ; la 21e compagnie prend les tranchées de
départ à huit heures du matin. Les hommes sont exténués par les combats de
Perthes, par les séjours en première ligne au moulin de Souin.
Ils ont devant eux la plaine immense, un glacis remontant vers les lignes
allemandes, semé de cadavres en tenue bleue, des camarades tués dans les
attaques de septembre.
Dans cet état de fatigue et de tension nerveuse,
ils attendent jusqu'à quatre heures du soir l'ordre d'attaquer.
À quatre heures du soir, l'ordre d'attaquer est
donné. Les hommes à ce moment-là, – nous ne pouvons pas les empêcher de se
rendre compte de ce qu'ils ont devant les yeux – jugent l'inutilité de
l'attaque.
Les officiers de la compagnie franchissent le
parapet criant : en avant ! Les hommes refusent de sortir. Ils disent :
"nous préférons être fusillés, mais être enterrés, que de rester à pourrir
là-bas, sur le bled. Ainsi, nous aurons au moins sauvé du massacre les
camarades de la 22e, qui doivent attaquer après nous."
On en rend compte à l'arrière.
À ce moment, le général qui commandait la 60e
division donne l'ordre, vous entendez bien, de tirer dans la tranchée
française, de tuer par conséquent les hommes qui étaient sortis, les gradés qui
étaient sortis, en même temps que ceux qui avaient refusé.
Le colonel Bérubé, qui
commandait l'artillerie divisionnaire, a refusé d'exécuter cet endroit (Applaudissements).
Il a exigé un ordre écrit que le général de division n'a pas eu le courage de
signer. »
M. Ferdinand Buisson : « le colonel Bérubé a déclaré plus tard que ce qui s'était passé là
était un assassinat. »
M. Jean Jadé : « c'est
l'unanimité des hommes, des sous-officiers et des officiers du régiment qui
vous diront que CETTE AFFAIRE A ÉTÉ UN VÉRITABLE ASSASSINAT. Mon camarade, le sous-lieutenant
Bordy, qui avait pris à ma place le commandement de
la compagnie, car, dans la matinée, j'avais été blessé grièvement, a été blessé
grièvement en effectuant une reconnaissance, puisqu'il a subi une amputation en
allant porté aux premières lignes la menace de cet ordre de faire tirer
l'artillerie française.
Par suite, le commandement prévient la 21e
compagnie que les pertes n'étant pas suffisantes, il y aura lieu de
recommencer l'attaque. À ce moment, on fait prendre à la compagnie le nom d'un
caporal et de quatre hommes par section auxquels on donne l'ordre formel de se
porter en avant, d'aller couper les fils de fer. »
M. Balanant : « en
plein jour ? » (Exclamations)
M. Jean Jadé : « en
plein jour ! »
M. Pierre Deyris : « c'est
formidable ! »
M. Jean Jadé : « ces
hommes étaient des braves ! Le Caporal Lechat, qui
est parmi les fusillés, avait été, la veille, volontaire pour une mission
périlleuse. Et quand il reçut cet ordre, ses camarades, les autres caporaux,
sont intervenus auprès du commandant de compagnie en disant : "Lechat a effectué une mission périlleuse la nuit dernière,
nous demandons de le remplacer."
Vous le voyez, nous avons affaire non seulement à
des braves, mais à des hommes de coeur.
Ces hommes reçoivent l'ordre de se porter en avant,
d'aller couper les fils de fer en plein jour.
Nous devinons immédiatement les mobiles qui ont
inspiré cet ordre. On n'osait pas faire comparaître toute une compagnie devant
le Conseil de guerre, alors on a donné un ordre formel à quelques hommes, de
façon à pouvoir justifier l'inculpation de refus d'obéissance.
Ces hommes auraient pu rester dans la tranchée ;
ils ont essayé d'obéir. Ils se sont portés en avant, ils ont vu les fils de fer
à 150 mètres, ils ont compris l'impossibilité d'aller les couper. Ils savaient
que c'était la mort certaine. Il y a tout de même quelquefois un instinct de
conservation qui empêche les hommes d'aller au-delà de la limite de leurs
forces (Applaudissements).
Ils se sont terrés dans un trou d'obus.
On les fait comparaître devant un Conseil de
guerre.
Au Conseil de guerre, constitué par des officiers
de l'arrière, dans lequel le colonel président était seul combattant, un
certain nombre d'officiers ont été appelés.
Quelques officiers du régiment ont demandé à être
entendus.
Refus formel du président du Conseil de guerre
d'entendre ces officiers.
Le commandant du bataillon, officiers de l'active,
a été entendu. Il a apporté un témoignage loyal. Il a essayé d'innocenter les
inculpés en exposant les conditions dans lesquelles avaient été commandées les
attaques.
Sa déposition a été hachée d'injures et
d'interruptions.
Le sous-lieutenant Germain, de la 21e, dont la
conduite cependant dans cette affaire avait été magnifique, a vu aussi sa
déposition hachée d'interruptions, et l'on a essayé de le mettre en
contradiction avec ses propres déclarations.
Le Conseil de guerre a impitoyablement condamné à
mort les caporaux Maupas, Lefoulon, Gérard et Lechat.
Puis il a signé un recours en grâce.
Malgré cela, l'exécution a été fixée au lendemain.
Elle a eu lieu dans les vingt-quatre heures et je crois savoir, sans pouvoir
l'affirmer, que l'ordre de surseoir à l'exécution est arrivé un jour ou deux
après.
L'exécution a eu lieu dans des conditions abominables.
Le régiment tout entier y a assisté. L'officier qui
commandait les officiers de la compagnie et tous les hommes pleuraient.
Le régiment était entouré de dragons dans la
crainte d'une révolte. »
------
Ce serait mentir de dire que ces faits n'ont pas
causé à la Chambre une émotion d'autant plus vive qu'ils lui étaient exposés
par un ancien combattant dont il n'était possible de mettre en doute ni la
sincérité, ni le courage.
Mais ce serait mentir aussi de ne pas dire que
cette émotion s'est vite apaisée, de sorte que ce débat tragique s'est
grotesquement terminé sur quelques propos du gluant M. Ignace, une lourde
pirouette de Bonnevay, et une impudente déclaration
de Barthou, à cette date Ministre de la Guerre : « je ne peux pas promettre
de sanctions ».
Donc, contre les officiers incapables qui, de
l'arrière, envoyaient les soldats à une mort inutile, le représentant de
l'armée au gouvernement ne peut pas promettre de sanctions. Pourquoi ? Sont-ils
trop ?
Dans tous les cas, il y a un fait précis qui
exigerait un châtiment sévère si l'autorité supérieure avait en quelque mesure
le sentiment de son devoir : c'est l'ordre donné par le général de division de
tirer sur la tranchée.
Que cet ordre fut criminel en soi, ce n'est pas ce
que je veux discuter ici. Je dis seulement : ou il était justifié où il ne
l'était pas.
S'IL N'ÉTAIT PAS JUSTIFIÉ, LE GÉNÉRAL, EN LE
DONNANT, A COMMIS UNE TENTATIVE D'ASSASSINAT.
S'IL ÉTAIT JUSTIFIÉ, LE GÉNÉRAL, EN REFUSANT DE
PRENDRE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉCRIRE, A FORFAIT À SON DEVOIR.
Se réservait-il donc, si des comptes lui étaient
demandés plus tard, de nier son ordre qu'il refusait de le signer ?
Le colonel Bérubé a très
noblement désobéi. Par quelle lâcheté suprême ne l'a-t-on pas poursuivi ?
N'est-il pas manifeste qu'on ne l'a pas osé parce
qu'il était plus difficile de faire fusiller un colonel que d'humbles soldats,
et parce que les débats auraient montré la misère intellectuelle et morale du
chef ?
La Chambre, cependant, n'a pas même demandé le nom
du général qui, en mars 1915, commandait la 60e division.
Et la Chambre non plus n'a pas fait la remarque que
dans l'odieux Conseil de guerre qui a envoyé quatre braves à la mort, tout
s'est passé comme si le Conseil, cette fois aussi, avait CONDAMNÉ PAR ORDRE.
Mais, plus révoltante encore que l'assassinat, est
la ruse par laquelle on s'est efforcé de le justifier : cette épouvantable et
basse rouerie qui consiste à exiger l'inexécutable pour avoir prétexte à
frapper.
« Nous devinons immédiatement »,
a dit, on s'en souvient, le capitaine Jadé.
Ils devinent quoi, ces combattants ?
Eh bien, que l'on donne à d'autres combattants une
mission au-dessus des forces humaines, en escomptant qu'elle ne sera pas
remplie et que l'on trouvera prétexte, dans leur impuissance, à les assassiner
également.
OR, C'EST UN PROCÉDÉ D'AGENT PROVOCATEUR.
Le chef qui a eu cette pensée et l'a exécutée a
atteint le dernier degré d'ignominie.
« Je ne peux pas promettre de sanctions » a déclaré
cependant Barthou...
Et la Chambre, unanime, ne s'est pas levée pour les
exiger !
Cette même Chambre, qui, l'avant-veille, malgré les
supplications ardentes d'officiers mutilés, avait refusé d'amnistier l'abandon
de poste dans un moment où tout le front était un poste, a permis à un ministre
de découvrir des crimes irrémissibles.
Quel spectacle !
Au 336e d'infanterie, il y avait des braves gens et
des misérables. Ce sont les braves gens que l'on a fusillés.
La Cour Suprême allait-elle au moins réhabiliter la
mémoire des victimes ? On l'aurait pu croire à la lecture de l'arrêt de renvoi,
rendu par la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'appel de Rennes le
1er octobre 1921.
Après avoir reconnu que la 21e compagnie du 336e
n'était pas sortie de la tranchée et n'avait pas exécuté l'ordre d'attaque qui
lui avait été donné, la Cour s'est posée cette question : "l'ordre donné à
cette malheureuse unité était-il matériellement exécutable " ?
Dans la négative, le crime de refus d'obéissance apparaît comme impossible et
ne saurait être retenu contre des hommes de la compagnie. C'est dans ce sens
que, courageusement, la Chambre des Mises en Accusation n'a pas hésité à se
prononcer.
Il est également certain, dit la Cour, que le 10
mars 1915 les hommes de la 21e compagnie, qui devaient se porter en avant, étaient
très fatigués par quatre journées de tranchées, en première ligne ; ils étaient
découragés par les attaques récentes dont ils avaient constaté et regretté
l'insuccès ; ils avaient sous les yeux les cadavres de leurs camarades tombés
dans les sorties récentes ou remontant à novembre et décembre ; ils voyaient
intacts les fils de fer allemands. Ils savaient que l'ennemi était en éveil ;
ils recevaient dans leur tranchée quelques obus français par suite d'un tir mal
réglé ou de défectuosité de munitions. Bref, il est incontestable qu'ils
devaient se trouver dans un état de dépression physique et morale très accentué
et le fait est attesté par le plus qualifié pour en témoigner, par le
lieutenant Morvan qui commandait leur compagnie.
Ce lieutenant a dit à l'instruction :
« A ce moment-là, aucun de mes hommes n'avait plus
la force morale voulue pour une attaque ».
Puis il a maintenu qu'il avait déclaré devant le
Conseil de guerre :
« Mes hommes étaient fatigués ; ils étaient comme
des sacs ou des cadavres. Ils étaient démoralisés par les attaques précédentes
qui avaient échoué ; mes hommes n'avaient plus de volonté ». Et il ajoute :
« mes hommes étaient
tellement inertes et hébétés que, quand j'ai donné l'ordre en avant, j'en ai
hissé quelques-uns sur le parapet, ils retombaient tous comme des masses dans
la tranchée ».
Cette appréciation a été confirmée à l'instruction
par le témoignage du sous-lieutenant Gracy :
« Les hommes n'avaient plus le ressort moral
suffisant pour faire le sacrifice de leur vie, et du premier coup d'oeil, nous
vîmes qu'aucune puissance au monde ne ferait sortir la 21e compagnie »
Appréciant le courage des quatre condamnés, la Cour
reconnaît que :
"Les renseignements fournis sur les quatre condamnés
sont excellents à tous égards, et ils avaient antérieurement donné des preuves
de bravoure. Ils n'étaient animés d'aucun esprit calculé d'indiscipline. Ils
ont failli dans un moment d'abattement qu'ils n'ont pu surmonter, et que les
circonstances ambiantes expliquent trop."
Et le magistrat de Roanne de conclure :
"La mémoire des quatre fusillés de Suippes
émerge de la tombe sous un jour favorable. Un de leurs juges du Conseil de
Guerre souhaite leur réhabilitation. Dans ces conditions précipitées, il
importe, en invoquant le motif suivant, de ne pas arrêter le cours de la
justice, ni la marche vers la vérité.
Considérant que la volonté, intelligente et libre,
est un élément essentiel de toute infraction à la loi pénale, qu'il ne semble
pas que, dans leur état de dépression physique et morale, les quatre caporaux
Girard, Lefoulon, Lechat et
Maupas, aient eu la volonté nécessaire, pour obéir le 10 mars 1915 à l'ordre
reçu de leur commandant de compagnie de marcher contre l'ennemi ; qu'à cet
égard, il existe tout au moins un doute dont ils auraient à bénéficier,
qu'impressionnés vraisemblablement par le souci de faire des exemples dans une
période critique de la guerre, et peu familiarisés avec le droit pénal, les
juges du Conseil de guerre apparaissent avoir été dominés par le fait de non
obéissance alors qu'ils devaient s'attacher en outre à l'élément
intentionnel du crime ; que, dans ces conditions, la sentence rendue est
sujette à faire l'objet d'un nouvel examen au point de vue de réformation :
Par ces motifs :
La Chambre des mises en accusation reconnaît qu'il
y a lieu de décision nouvelle au sujet de l'affaire sus-visée.
Ordonne en conséquence, le renvoi du recours et de
la procédure à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour qu'il soit statué
définitivement sur le fond par cette juridiction de jugement."
Qu'allait faire dans ces conditions la plus haute
juridiction du pays ? Reprendre purement et simplement ces attendus présentant
sous son véritable jour l'affaire des quatre caporaux de Suippes ? Du tout.
M. le conseiller Lecherbonnier,
chargé du rapport, s'était cependant déclaré favorable à la révision.
Les conclusions de Monsieur l'avocat général Wattine paraissaient devoir entraîner la cassation des
scandaleuses condamnations. Il disait, ce haut magistrat :
" La disposition exceptionnelle de l'article
20 de la loi du 29 avril 1921, permet d'envisager le point de fait sous toutes
ses faces. C'est ainsi qu'à la faveur de cette disposition, on est amené à
rechercher quelle était la situation morale des condamnés au moment où
ils ont refusé le service qui leur a été imputé. Avaient-ils alors une
conscience suffisante de leurs actes pour qu'on doive les considérer comme
pleinement responsables ?
Non, répond sans hésitation aucune l'avocat général
Wattine, s'appuyant sur les dépositions des chefs des
pauvres victimes, les représentant au lendemain de l'attaque, exténués,
découragés, démoralisés. "
"En présence de ces témoignages, écrit-il, on
est autorisé semble-t-il, à demander à la Chambre Criminelle de décider que les
quatre fusillés de Souin n'avaient plus conscience
de leurs actes au moment où ils ont opposé une résistance passive aux ordres de
leurs chefs et de réformer pour ce motif la décision qui les a condamnés.
C'est dans cet ordre d'idées que nous demandons à
la Cour de tenir compte, autrement que ne l'on fait les juges du Conseil de
guerre, de l'état de dépression allant jusqu'à l'inconscience dans laquelle se
trouvaient les condamnés dans la fatale journée du 10 mars 1915. Il est, du
reste, constaté que jusque-là ils avaient été de bons soldats. Lorsqu'ils ont
failli, c'est dans un moment d'abattement qu'ils n'ont pu surmonter. Il
n'est pas excessif de considérer qu'à ce moment ils étaient irresponsables."
En conséquence, le Procureur général requiert qu' il plaise à la cour de :
" Réformer la décision du conseil de guerre de
la 60e division d'infanterie en date du 16 mars 1915 "
La Cour de Cassation n'en a pas tenu compte. Tant
pis pour la justice ! Mais ce qui reste, c'est l'arrêt de Rennes : "La
mémoire des quatre fusillés de Suippes émerge de la tombe sous un jour
favorable". Il faut s'en souvenir !
-----
Dix ans ont passé. Aucune des quatre victimes n'a
été réhabilitée.
Cependant
- La veuve de Sicard a reçu le titre de médaille
militaire conférée à son mari à titre posthume. La citation est la suivante,
datée du 24 décembre 1922 :
" Sicard Louis -- Victor -- François,
caporal, brave, dévoué, tombé le 17 mars 1915 en accomplissant brillamment sans
devoir devant Suippes "
- La famille Lechat a
reçu le diplôme attribué aux familles des soldats morts au champ d'honneur.
- M. Lefoulon a obtenu le
transport gratuit des restes de son fils.
- Mme Maupas et les trois autres familles des fusillés
ont bénéficié pendant plusieurs années des avantages qui, en fait, supposent
l'innocence des fusillés et exigent, en droit, leur réhabilitation officielle.
Enfin, le Conseil Général de la Manche, dans sa
séance du 5 septembre 1923, a émis le voeu que le nom de Maupas figurât sur le
monument élevé à l'École Normale de Saint-Lô à la mémoire des instituteurs
morts pour la France.
Pour différentes raisons, ce dernier hommage a été
différé. Pourtant, tout permet de penser que la réparation prochaine n'en sera
que plus éclatante.
La loi du 3 janvier 1925 autorise, en effet, la
Cour de Cassation à reprendre, toutes Chambres réunies, les affaires
précédemment rejetées par la Chambre criminelle.
Le Garde des Sceaux a transmis à la Cour le dossier
des quatre fusillés, établi de nouveau par la Ligue des Droits de l'Homme.
Souhaitons que cette fois justice sera faite !
-----------------------
Les 4 hommes furent finalement réhabilités en mars 1934
![]()
Retour accueil Retour page précédente