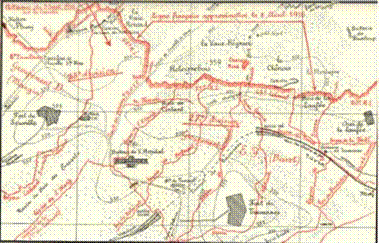Le tunnel de TAVANNES
(Par René le
GENTIL)
« Je peux vivre cent ans, je me souviendrai
toujours des heures vécues dans ce ghetto, tandis qu'au-dessus la mitraille
faisait rage.
Imaginez un boyau long de quinze cents mètres, large
de cinq, fait pour une seule voie par où passait le chemin de fer allant de
Verdun à Metz et où de 1000 à 2000
hommes travaillaient vivaient, mangeaient et satisfaisaient à tous leurs
besoins!... »
(René le GENTIL)

Dans
les premiers temps de la lutte gigantesque autour
de la cité, des troupes, cherchant un abri contre le déluge de fer et de plomb,
s'abritèrent là; puis, comme cela durait, des services s'installèrent au petit
bonheur, à l'entrée et à la sortie.
Un jour enfin, quelqu'un constatant que
ce tunnel constituait le plus sûr des abris et pouvait servir à quelque chose,
décida d'y installer tous les services du secteur. Des cabanes furent aménagées
par le génie qui y prit sa place, planches, tôles ondulées, toiles goudronnées
furent mobilisées et formèrent les baraques qui devaient donner asile à cette
fourmilière militaire, du moins aux autorités, aux services.
Avec
de l'organisation, c'eût été d'une utilisation
intelligente, mais... la dynamo qu'on y avait installée était trop faible et ne
pouvait fournir qu'un pauvre éclairage, si bien qu'on y voyait à peine et qu'on
manquait à chaque pas de glisser sur le bout des traverses de la voie ; mais,
chose pire, l'eau manquait absolument, car un seul robinet existait au milieu
du tunnel; et ceux qui venaient la étaient condamnés à rester des dix, voire
douze et quinze jours sans se nettoyer, malgré les pires besognes à accomplir.
C'est ainsi que j'ai vu de nos hommes,
qui venaient de s'infecter les mains en transportant des cadavres délabrés,
être obligés de manger sans pouvoir se laver. Et quand je demandai pour eux un
désinfectant quelconque l'aimable pharmacien (Il fut tué quelques jours après),
chargé de ce service, me fit des reproches amers. Je compliquais les choses en
réclamant ainsi !
Ah !! L’hygiène du tunnel de
Tavannes, transformé en égout humain!
Après
deux ans de guerre et cinq mois que durait la lutte
devant Verdun, on n'avait pas encore pu installer quelques ventilateurs
renouvelant l'air méphitique qu'on y respirait, ni le désinfecter en vaporisant
quelque chlorure.
Au milieu, vous entendez bien, juste au
milieu des couchettes étaient les latrines !
On eût pu se servir d'une double série
de tinettes désinfectées, emporter les pleines, mettre les vides à leur place.
C'eût été trop simple et propre. Les territoriaux vidangeurs les tiraient,
vidaient leur contenu dans des boîtes rectangulaires à brancards munies de
couvercles qui s'adaptaient rarement, et les remettaient en place... emportant
le long du tunnel leur marchandise empuantant
l'atmosphère!
J'ai vu faire cette besogne, tandis que
les hommes mangeaient leur soupe - dans des gamelles ou assiettes qu'ils ne
pouvaient, faute d'eau, nettoyer - à côté d'eux !

Après
les différents services, les hommes s'installaient comme
ils pouvaient... sur la voie même du chemin de fer, dans le noir complet, la vermine
et la saleté. Il y avait bien eu un timide essai de cadres treillagés qui
avaient servi de couchettes, mais ils étaient défoncés, abîmés, et les
divisions se succédant rapidement, hélas! nul ne s'inquiétait de les remplacer
; toutefois, voulant dégager le bas, le génie du secteur avait commencé
l'installation, à mi-hauteur du tunnel, d'un premier étage en plancher; là
gîtaient les territoriaux ; mais comme il n'y avait pas de place pour tout le
monde, cela ne faisait qu'augmenter encore, pour ceux qui étaient en dessous,
le grabuge infernal et la saleté qu'on n'avait plus seulement aux pieds, mais
encore sur la tête; car, par les planches mal jointes, la terre tombait sur
ceux qui se trouvaient là.
Quant
à reposer, à dormir un moment, à moins d'être sourd,
il n'y fallait songer. Les cabanes contenant les services et les abris des
chefs prenant, avec la voie, tout le côté droit du tunnel, il ne restait guère,
pour aller et venir, qu'un espace de 1,15m, du côté gauche.
Or, c'est par cet étroit chemin que
passaient tous les groupes, les troupes allant relever celles qui attendaient,
les territoriaux et le génie montant au « travail » avec leurs outils ; c'est
par cet espace où, à la file, se suivaient parfois pendant des heures des
centaines et des centaines d'hommes, qu'il fallait assurer, dans des conditions
pénibles, l'évacuation des blessés, -- quelquefois des cadavres - qu'on amenait
des lignes, et qu'on évacuait ensuite sur le « Cabaret Rouge », relais
automobile, à près de deux kilomètres de là, et ce, à bras.
Double
manœuvre pénible où des hommes, souvent éreintés
par le chemin fait sous les obus et pouvant à peine regarder à terre,
manquaient à chaque pas de glisser sur les traverses ou les rails d'un petit
Decauville qui ne fonctionnait pas! ... naturellement.
On aurait pu, évidemment, mettre les
postes de secours et celui des brancardiers au commencement du tunnel;
l'évacuation eut été plus rapide, les blessés et ceux qui les portaient y
auraient gagné, le service aussi, mais cela encore eut été trop simple, et on
les avait logés à deux cents mètres à l'intérieur!
On aurait pu, puisqu'on avait installé
un Decauville qui allait jusqu'au « Cabaret rouge », s'en servir, évacuer par
ce moyen, mais on ne jugeait pas ce système assez long et compliqué.
Au milieu du tunnel, il y avait même un
dépôt de munitions et, chaque soir, nous nous demandions anxieusement si les
territoriaux qui passaient, en transportant les caisses de grenades sur leurs
épaules au moyen d'une perche qui fléchissait sous le poids, n'allaient pas
glisser et laisser choir leurs terribles citrons de fonte !
Un
jour, on entendit une explosion : un madrier
était tombé sur une caisse de grenades; il y eut un tué et deux blessés.
Le lendemain, en mettant de l'ordre dans
notre poste, j'ouvris une caisse qui nous servait de siège et sur laquelle je
faisais mon courrier ; il y avait là tout ce qu'on voulait, et même ce qu'on
n'eût pas voulu ; de vieux masques contre les gaz, des paquets de pansements
individuels, des biscuits et... des grenades chargées. Je les fis enlever par
mon brave DEHLINGER, qui connaissait cet article.
Régulièrement, les deux ravins formant
l'entrée et la sortie du tunnel étaient arrosés par la mitraille, par des
projectiles qu'on n'entendait presque jamais venir, à cause du départ de nos 75
qui donnaient par batterie, sans discontinuer; aussi l'évacuation des blessés
était-elle chose pénible et dangereuse. Pénible, difficile, à cause du chemin
accidenté.
Représentez-vous une voie de chemin de
fer avec, de chaque côté, un contre-bas, un petit espace plein de trous, de
bosses, de traverses, de pierres détachées, parfois de troncs d'arbres abattus
; dangereuse, par les tirs de barrage que l'ennemi ne manquait jamais de
déclencher deux, trois fois par jour, surtout aux heures de ravitaillement.
Ajoutez à cela la pluie tombant
régulièrement et détrempant une terre grasse qui s'attachait aux pieds,
emplissait les trous d'obus ou en creusait d'autres qu'on ne pouvait pas
combler.
Demande
d’envoi d’une carte plus grande par mail
Or,
sans grand travail, on eût pu établir sur la droite,
un boyau spécial pour l'évacuation des blessés, au moins jusqu'au croisement de
la voie, chemin le plus dangereux, jusqu'au point appelé : « La Maisonnette »,
habitation de l'ancien garde-voie, ouverte de tous côtés par les obus. Abrité
par le talus droit, ce boyau eût facilité le transport en diminuant les
risques; mais, de même que les rails du Decauville, le boyau était là pour
faire penser qu'on aurait pu l'utiliser!
Ah! Oui, toute ma vie je me souviendrai
de ce tunnel de misère, ghetto de guerre où, par le même étroit espace,
passaient l'héroïsme sanglant et les ordures, les territoriaux vidant les
latrines et les ravitailleurs portant la soupe, et où les cadavres qu'on
transportait bousculaient parfois les vivants !...
Le Tombeau de Tavannes
Près
de mille hommes périrent le 4 septembre 1916
Blessé,
évacué à Contrexéville, où, après cinq étapes et
quarante heures de trajet sur le dos, j'avais trouvé un lit, de l'eau et du pain
frais, le calme après la tempête, le paradis après l'enfer, je venais à peine
d'achever les lignes qui précèdent sur le tunnel de Tavannes, quand, le 7
septembre, je trouvai dans mon courrier un mot de mon brave DEHLINGER, daté du
3, m'annonçant que les obus avaient déjà causé des vides dans nos rangs, et se
terminant ainsi :
« Nous aspirons tous au repos bien gagné
».
Et
un autre camarade, le sergent MONIN, chimiste et,
comme tel, attaché au laboratoire de toxicologie, qui se trouvait à l'autre
bout du tunnel, du côté de La Lauffée-Damloup, m'écrivait :
« ... Ici, sous le tunnel, toujours la vie que tu
connais, nous avons été alertés deux fois par les gaz, et l'entrée a été, hier
soir, sérieusement marmitée par un tir de barrage. La santé n'est pas brillante,
mais nous espérons sortir bientôt indemnes de ce trou infect…»
Mais,
le dimanche 10, tandis que j'attendais la visite et
goûtais de mon lit la caresse d'un rayon de soleil illuminant le parc de
Contrexéville, je reçus d'un camarade ce mot laconique qui me glaça :
« MON CHER LE GENTIL,
•
Comment allez-vous? J'espère que votre blessure n'aura pas de suite fâcheuse.
• Vous
aurez sans doute appris l'affreux malheur? Cent-un exactement de nos malheureux
camarades sont restés ensevelis sous le tunnel de Tavannes Tous morts!...
•
Pauvre groupe de brancardiers déjà assez éprouvé, le voici presque anéanti !
• Comme
sergents survivants, il ne reste que KOHLER et MONGEOT. Quelle affreuse chose
que la guerre ! »
Je
restai un moment hébété, ne pouvant croire ce que
j'avais sous les yeux, en proie à une émotion intérieure qui mouillait mon
front.
Non, je n'avais rien su, rien appris.
Comment? Par qui?
Seul, ce bout de papier me révélait une
catastrophe sur laquelle je n'avais aucun détail.
Mais un convoi de blessés venait
justement d'arriver à l'hôtel de la « Souveraine », et des hommes de ma
division me confirmèrent la triste nouvelle.
Le 4 septembre, une formidable
explosion, sur la cause de laquelle on n'était pas fixé, avait eu lieu sous le
tunnel, faisant près d'un millier de victimes, dont les brancardiers de la 73e
division.
Ma pensée angoissée alla vers mes
infortunés camarades, mon peloton, et DEHLINGER qui m'avait écrit le 3, la
veille ! ...
Cent-un! Me disait le mot laconique.
Je songeai un instant que, peut-être,
mon peloton avait été relevé. J'essayai de m'accrocher à de fragiles espoirs;
mais, de la journée je ne pus penser à autre chose ;
et c'est à peine s'il me fut possible de fermer l’œil.
Le
lendemain matin, je reçus ce billet qui me fixa sur
l'étendue du malheur:
« CHER MONSIEUR LE GENTIL,
Une
bien triste nouvelle à vous apprendre! ... Joseph DEHLINGER est resté «là-haut»
avec pas mal de camarades, cent un, quatre pelotons, et il n'y a plus aucun
espoir! ... Nous restons cinq de notre pauvre peloton. MARTIN Camille, BOËS,
VERA, PEZAT, l'équipe 23 qui se trouvait à Fontaine Tavannes, et moi qui, par
suite d'une heureuse chance, remplaçais depuis deux jours KELLER, comme
vaguemestre.
« Nous
sommes redescendus à Dugny, mais c'est bien triste de se voir si réduits ! ...
Vous aurez probablement reçu vos colis et paquet de lettres que nous vous avons
fait suivre ; le pauvre joseph me les avait remis le soir même. Je ne peux vous
donner pour l'instant plus de détails.... J'espère que votre blessure est en
bonne voie de guérison, mais quelle veine vous avez eue! ...
« HENRI
MARTIN.»
Oui, en effet!
Pauvres
malheureux camarades! Infortuné joseph DEHLINGER que
j'avais embrassé quelques jours avant, lorsque, évacué du tunnel de malheur au Cabaret-Rouge
sur un brancard, il avait tenu à m'accompagner.
Pauvre brave joseph, déjà blessé l'année
précédente au bois Le Prêtre, que j'avais connu à Toul et que sa femme et sa
petite fille m'avaient recommandé et attendaient dans leur petite maison de Nancy....
Et dire que c'est à lui que j'avais
confié, avec mes papiers, mes dernières volontés au cas où j'aurais été frappé
à mort !
Quelle cruelle ironie du sort.
Chose curieuse, de tout mon peloton, la
seule équipe sauvée était précisément celle qui, déjà, avait échappé à la mort
en descendant de la batterie de l'Hôpital et justement celle qui m'avait
évacué. Les quatre qui m'avaient porté, auxquels j'avais souhaité bonne chance
! Pourquoi, le sort n'avait-il pas de même préservé le pauvre DEHLINGER, seul
marié et père de famille?
Et
les autres?
Sur vingt-quatre hommes de mon peloton,
un avait été blessé deux jours après moi, un autre évacué pour maladie; quatre
et un caporal restaient survivants! Dix-sept hommes et deux caporaux étaient
donc restés « là-haut », dans cet antre de souffrance et d'horreur, avaient
péri dans la géhenne, pauvres misérables humains auxquels, après de longs jours
et de pénibles nuits de privations - car on n'était que piètrement ravitaillé -
de surmenage et de danger pour accomplir leur rude, ingrate et sanglante
besogne de parias, la guerre, insatiable gouge, dévoreuse d'hommes, avait
réservé un sort atroce.
Cent-un des nôtres, les quatre pelotons
de service avaient été anéantis.
J'ai connu, depuis, dans quelles tristes
conditions.
Le
4 septembre
La nuit et la journée avaient été
particulièrement dures pour les brancardiers qui n'avaient pas arrêté un
instant; pour leur permettre de reposer quelques heures, dans la misère de cet
antre empuanti, leurs pauvres corps fourbus, leurs épaules meurtries, le
médecin-major BRUAS avait demandé les brancardiers de Corps en réserve.
Quand ces derniers furent là, à mesure
que rentrèrent les équipes divisionnaires, ceux qui les composaient s'en furent
allongé leurs membres brisés.
A 21 heures, les quatre pelotons
reposaient, et les malheureux qui s'étaient laissés tomber sur le plancher sans
paille ou la terre pourrie, à bout de forces, dormaient là, confiants en la
solidité de cet abri sur lequel pouvaient pleuvoir les obus de tous calibres.
Grâce au docteur BRUAS, chef juste, ils
pouvaient reposer un peu avant de continuer leur lourde et périlleuse tâche.
Mais, comme s'il n'y avait eu assez de
l'ennemi, de la mitraille, de la pluie, de la boue, de la faim, de toutes les
infernales misères de la guerre, c'est ce moment où tous ces malheureux,
vaincus par la fatigue, dormaient profondément, rêvant peut-être aux leurs, au
foyer, au bonheur... c'est cette minute que choisit l'implacable destin, entre
les mains duquel, quelles que soient nos prétentions, nous ne sommes que de
pauvres instruments, pour frapper ces hommes que le sort avait déjà transformés
en forçats de la Patrie.
Quelle fut la cause
initiale de la catastrophe ?
Plusieurs
versions en ont été données sans qu'il soit
possible d'être exactement fixé.
Un mulet transportant des grenades
aurait buté contre une traverse de la voie et fait choir sa terrible cargaison,
provoquant, avec la panique, une explosion d'essence et l'incendie.
Un territorial portant des fusées aurait
accroché les fils électriques, une cause quelconque aurait provoqué l'explosion
des mines placées pour faire sauter le tunnel en cas d'avance de l'ennemi.
Or, on peut écarter cette dernière
version, les cordons Bickford reliant ces mines ayant été retrouvés intacts.
Toujours est-il qu'à la suite d'un
accident, le groupe électrogène placé à l'entrée sauta, causant l'incendie des
baraquements où logeaient les services suivants : Poste de commandement du chef
de la brigade occupant le secteur; bureaux du médecin divisionnaire et du
médecin chef, du téléphone, du génie, postes de secours et de brancardiers,
etc., etc. Dans cet étroit boyau où s'amoncelaient, comme à défi, les matières
les plus combustibles, le feu se propagea rapidement, hélas ! et les malheureux qui se trouvaient là, guettés par la
flamme et l'asphyxie, fuyaient en groupe du côté opposé.
Si
la chose avait été possible, il n'y aurait
eu comme victimes que celles qui se trouvaient enveloppées par le feu des
premières cabanes; mais, lorsque le destin qui permet à tant de misérables et
d'inutiles une longue vie de tout repos, tient en ses griffes des malheureux,
il ne les lâche pas ainsi ! ...
Ces hommes, tirés de leur sommeil pour
vivre le plus atroce des cauchemars, fuyaient donc, pêle-mêle vers l'autre
issue, à travers les flammes, et, pour lutter contre la fumée qui, par l'appel
d'air de ce long boyau, les gagnait de vitesse, la plupart avaient adapté les
masques contre les gaz. Dans ce tunnel devenu le huitième cercle de l'Enfer,
des centaines de damnés masqués participaient à cette course à la mort,
butaient contre les traverses, tombaient sous les pieds des camarades,
hurlaient le : « Sauve qui peut ! » féroce et égoïste de l'homme en danger,
quand, devant eux, une terrible explosion se produisit... un feu d'artifice
jaillit... trouant l'obscurité d'éclairs effroyables: c'était le dépôt de
munitions qui sautait !
Le déplacement d'air fut tel que ceux
qui se trouvaient à la sortie, du côté de Fontaine-Tavannes, faillirent être
renversés.
Les premiers infortunés qui fuyaient de
ce côté, et dont pas un n'avait encore pu franchir le dépôt de munitions,
furent donc certainement renversés; la position d'un tas de cadavres, trouvés a cet emplacement, corrobore, d'ailleurs, cette hypothèse.
Feu devant, feu derrière, prise entre
les flammes et gagnée par l'asphyxie, la pauvre troupe, hurlante et douloureuse
vit la mort s'avancer à grands pas...
Seuls, René BIRGÉ, secrétaire du colonel
FLORENTIN et dessinateur de la brigade, enseveli par un heureux hasard tout à
l'entrée, et un homme du 8e ou 10e génie, purent être assez heureux pour
échapper à la catastrophe ; dès le début, ce dernier avait pu s'évader par
l'unique bouche d'air existante, en gagnant l'ouverture grâce à une échelle, et
d'autres malheureux le suivaient, quand, sous leur poids l'échelle se brisa!...
Près de mille
hommes périrent donc là : Etat-major de la 146e brigade, colonel FLORENTIN en tête, officiers et soldats des
8e et 1e génie et des 24e,
98e et 22e régiments territoriaux ;
médecins majors et infirmiers régimentaires des 346e, 367e, 368e et
369e d'infanterie; blessés de
ces régiments qui, après de rudes souffrances, attendaient là, sur des
brancards, leur transfert.
Vous, médecin major Bruas que je regrette doublement, puisque je vous dois la vie, et dont, seule trace de votre fin, on n'a retrouvé que la chevalière !… Et vous, les médecins et brancardiers de la 73e division.
Lorsque, deux jours plus tard, on put
déblayer l'entrée du tunnel, on ne
retrouva rien, rien que des restes humains calcinés qui tombèrent en poussière
dès qu'on les toucha.
Plus loin, là où le feu n'avait rien eu
pour s'alimenter, il fut possible d'identifier quelques cadavres, trente
seulement sur cent-un ! Ce fut â peu près la proportion pour tous les groupes
anéantis en cette catastrophe.
Une autre version,
très plausible, veut que ce soit le dépôt de munitions qui sauta le premier.
L'historique
du 356° R.I. relate :
L’explosion à l'intérieur du tunnel de
Tavannes est survenue le 04 septembre 1916 à 21h15.
"Un quart d'heure après, une vague épaisse de fumée remplit le tunnel
jusqu'au-delà de la cheminée centrale et gagne rapidement la sortie est. La
nappe de gaz est intense et chargée d'oxyde de carbone. Des centaines de
soldats tombent asphyxiés. Il est impossible, même avec des masques et des
appareils respiratoires, de pénétrer dans le souterrain pour opérer le
sauvetage de la garnison et des services qui s'y trouvent...
A 21h45,
des hommes à demi-asphyxiés et à demi vêtus, surgissent du tunnel par petits
groupes : ils sont recueillis par la C.H.R. et l'état-major du 356° R.I. qui occupent des
abris à proximité de la fontaine de Tavannes. Les nappes de fumée, en
brouillard opaque, se répandent au loin et montent très haut dans le ciel ;
elles provoquent de la part de l'ennemi un redoublement d'artillerie ; les obus
interdisent les accès du tunnel.
Lorsque, dans la nuit, les premiers
secours essayent de pénétrer, ils se heurtent à d'effroyables décombres et à des
morceaux de cadavres calcinés.
Pendant trois
jours, l'incendie fit rage à l'intérieur. Quand il s'éteignit, les équipes de
secours découvrirent une pile de corps carbonisés au-dessus d'un puits
d'aération, par lequel les malheureux avaient vainement tenté de fuir."
Naturellement, aucun journal n'en souffla mot.
Nul, parmi
les officiels de la « Grande Presse », ne fut commis à saluer les malheureuses
fourmis humaines dont le tunnel de Tavannes fut le tombeau; mais leur mémoire ne
m'en est que plus chère ; et c'est en survivant, pénétré de ce que nous devons
à ceux qu'immola le destin, que je l'évoque ici de mon mieux, en les saluant
d'un souvenir ému.
René le
GENTIL
![]()
Le tunnel
actuellement emprunté par les circulations ferroviaires est un tunnel mis en
service en 1936. Il a été creusé à quelques mètres en parallèle du tunnel
primitif où se sont déroulés les événements du 04/09/1916. De nos jours, on
peut distinguer les deux entrées de tunnel à quelques mètres l'une de l'autre.
Les rails ont été déposés sur le tunnel d'origine. Attention, le terrain est
d'accès interdit !


![]()
Essayer de retrouver une photo d’un ancêtre soldat
Retour accueil général du site