La bataille et le siège de MAubeuge
27 août - 8
septembre 1914
Le Gouverneur; ses essais de
réorganisation
L'organisation de
défensive avant l'investissement
Les premières semaines de
guerre
La ville de Maubeuge est maintenant sur
la ligne de feu.
A fin de juillet 1914 la place de Maubeuge est ainsi constituée :
Tout autour de la ville, l'enceinte, datant de Vauban.
A une distance d'environ trois à six kilomètres de cette enceinte, six forts : Boussois Les Sarts Leveau Hautmont Le Bourdiau Cerfontaine. Ils sont tous antérieurs à 1885, c'est à dire à l'apparition de l'obus torpille qui a révolutionné l'art de la fortification.
Seul, Le Bourdiau est revêtu d'un cuirassement de béton à l'épreuve de l'artillerie lourde de campagne.
Dans les autres ouvrages, les abris en maçonnerie sont recouverts d'une simple couche de terre de 3 mètres d'épaisseur (0.50m parfois: Les Sarts)
Du type à massif central ou à cavalier, ces forts constituent des objectifs parfaitement visibles de tout le terrain environnant.
Entre chacun de ces forts existe un ouvrage intermédiaire (deux entre Le Boussois et Les Sarts). L'ouvrage de Rocq, dans le secteur sud est, est constitué par un simple parapet d'infanterie avec de mauvais abris en maçonnerie, tandis que les autres sont pourvus de faibles abris bétonnés pour hommes assis.
Les garnisons de ces ouvrages n'auront à leur disposition ni magasins, ni cuisines, ni infirmeries. L'eau est tirée de puits qui seront facilement détruits par un bombardement.
Les ouvrages intermédiaires sont séparés des forts par des intervalles considérables.
Les forts ne disposent, comme matériel de flanquement, que de pièces de 80 ou de 90, à l'air libre: elles seront bien vite mises hors de cause par l'artillerie adverse. Seuls, Le Boussois et Cerfontaine sont pourvus de deux tourelles Mougin en fonte dure pour canon de 155, et de trois tourelles de 75.
A signaler que, contrairement à ce qui existe dans nos grandes places de l'Est, Maubeuge n'a pas de chemins de fer Péchot pour relier les différents organes de la défense.
Le
Gouverneur; ses essais de réorganisation.
Depuis le 17 mars 1914, le gouverneur de Maubeuge est le général Fourrier, qui sort de l'arme du génie et qui a eu déjà l'occasion de se distinguer en temps de paix, lors de l'organisation de la place de Bizerte.
En arrivant à Maubeuge, le général Fourrier a été péniblement impressionné par l'état lamentable de la place.
Il a mis, dés lors, toute son énergie à la réfection de la forteresse et exigé de chacun de ses subordonnés (effort maximum en vue de l'intérêt commun.
Le général Fourrier sent, en effet, que la guerre est prochaine. Ses prévisions ne le trompent pas
Le conflit mondial vient le surprendre en pleine période de réorganisation.
Son activité redouble dés le 2 août 1914: bien que le plan de défense ne lui prescrive de commencer l'exécution des travaux prévus que le sixième jour de la mobilisation, le général Fourrier ne veut pas perdre une heure.
Il sait tirer parti de toutes les ressources nouvelles mises à sa disposition. Il réquisitionne 6.000 civils, auxquels il adjoint 25.000 territoriaux ou réservistes envoyés à Maubeuge, et les emploie, sous la direction d'officiers du génie, aux travaux les plus urgents.
L'organisation
de défensive avant l'investissement
Dés lors, c'est une période d'activité fébrile qui commence. Le jour commence à poindre et déjà les corvées de travailleurs sont rendues sur les chantiers.
Elles s'emploient à renforcer la zone principale de résistance, devant laquelle doivent venir se briser les efforts des Allemands, si ceux ci arrivent jusque devant Maubeuge. Sans trêve les hommes remuent la terre; ils édifient en toute hâte des ouvrages nouveaux: Le Fagnet, qui doit boucher entre Le Boussois et La Salmagne la trouée pouvant conduire l'ennemi dans la ville.
Les autres intervalles qui séparent les forts sont également rétrécis par (établissement d'ouvrages de fortune, par le renforcement de points d'appui déjà existants, comme La Salmagne, Bersillies, Gréveaux, Ferriére la Petite et Rocq, tous convertis en Centres de Résistance.
Voir des photos actuelles de tous
ces forts
Tandis que des travailleurs portent à six mètres l'épaisseur des parapets d'infanterie, des équipes amènent des rondins, des plaques en fer de 5 cm qui servent à l'édification d'abris recouverts de 1 à 5 mètres de terre ; Mais ce ne sera là qu'une bien précaire protection pour les combattants.
Plus loin, des soldats du génie s'emploient à abattre les arbres, à faire sauter les maisons qui pourraient gêner la visibilité ou rétrécir les champs de tir. Le village d'Elesmes, en particulier, subit d'importantes destructions.
D'autres équipes vont poser en trois semaines 1500000 piquets autour desquels s'enlacent des milliers de kilomètres de fil de fer barbelé; ces immenses réseaux, couvrant une superficie totale de 100 hectares, entourent bientôt chacun des ouvrages et s'étendent dans les intervalles qui séparent les points d'appui.
En arrière de la ligne des forts, des terrassiers s'emploient à niveler le sol pour permettre la pose d'une voie ferrée étroite, qui reliera entre eux, et jusqu'au cœur de la place, chacun des ouvrages de la défense : 20 kilomètres de rails sont établis en vingt-sept jours.
Des artilleurs amènent leurs canons tout prés de la première ligne : il n'y a pas d'échelonnement des batteries en profondeur, car les instructions ministérielles de 1910 prescrivent que « l’armement de Maubeuge doit permettre, dés le début, une action aussi lointaine que possible des ouvrages actuels ».
Les dépôts de fortune pour munitions sont installés à proximité des pièces : chaque canon disposera immédiatement d'environ 300 coups à tirer.
Une position de soutien a été également ébauchée : elle est marquée dans le secteur est par les villages d'Élesmes et d'Assevent, distants de deux à trois kilomètres de la première position; elle possède donc là des champs de tir assez étendus, et sa défense peut être envisagée comme très possible après la chute de la zone principale.
Par contre, au delà du secteur Élesmes Assevent, la ligne de soutien passe immédiatement en arrière de la ligne des forts et des ouvrages, et il est à craindre qu'en cas d'évacuation de la zone principale, les combattants ne puissent s'accrocher à la ligne de soutien (Mairieux bois des Saris Douzies Louvroil lisière est du bois des Bons Pères). Et en arrière il n'y a rien, rien que les vieux remparts de Vauban, qui datent de deux siècles.
En avant de la zone principale, une position avancée n'est constituée que dans le secteur sud-ouest : Dans les bois d'Hautmont et du Quesnoy qui sont très rapprochés de l'important village d'Hautmont, inclus dans la zone principale.
On pourrait peut être faire mieux, mais le temps manque aux défenseurs de Maubeuge.
La garnison a d'ailleurs fourni un tel effort
par ces journées torrides d'août 1914 qu'elle commence à être sérieusement
fatiguée.
Une conséquence
plus grave encore découle de la nécessité de pousser activement les travaux
Les
territoriaux et les réservistes n'ont pu être remis en main et soumis à un
entraînement progressif. Et pourtant l'instruction des troupes aurait besoin
d'être sérieusement revue. C'est ainsi que les régiments de territoriale qui,
jusque là, n'étaient pas dotés de mitrailleuses, viennent d'en recevoir. Dans
ces corps, bien peu d'officiers connaissent le maniement des armes
automatiques; trois semaines ne suffiront pas à la formation des équipes,
surtout avec un outil aussi délicat que la Saint Étienne.
Faute de mieux,
on chargera les pièces sur des voitures de réquisition, système bien primitif, et
qui offre de nombreux inconvénients.
Dans toutes les
parties de la défense de Maubeuge, on retrouve ainsi le même caractère
d'improvisation, qui va mettre les Français en bien mauvaise posture vis à vis
des Allemands, superbement dotés en moyens de toutes sortes.
Et à l’origine
de ce défaut de préparation, apparaît toujours la même cause : le manque de
crédits qui n'a pas permis d'organiser solidement Maubeuge en temps de paix.
Ces effectifs
comprennent
à Un seul
régiment d'active : le 145e régiment
d’infanterie de ligne,
qui formait, en temps de paix, la garnison de la place;
à Quelques
régiments de réserve : le 345e
Deux régiments d'infanterie coloniale 31e et 32e, dont une forte partie de l'effectif est constituée par des
soldats de métier, et dont la majorité des cadres est formée par des officiers
et sous officiers de carrière : ces unités sont excellentes
àLes
régiments territoriaux suivants
1,2,3,4e, un bataillon du 5e, deux bataillons du 85e. Beaucoup d'officiers de
ces régiments sont vieux et fatigués, absolument inaptes à faire campagne
àDeux
bataillons de douaniers de
250 hommes chacun;
àUn
millier de G. V. C.
Soit 33.000
fantassins, dont 20.000 soldats de la territoriale.
L'artillerie comprend un groupe de quatre
batteries territoriales de 75 montées.
De plus, 69 pièces sont affectées à la réserve
d'artillerie, et des groupes d'attelage sont constitués pour les mouvements
éventuels à faire exécuter à ces pièces ; mais, là encore, le nombre des
groupes est insuffisant, et l'on ne pourra atteler à la fois la totalité des
canons.
Le reste de
l'artillerie (350 canons courts ou longs, de 220, 155, 120 95, 90, 80) est
réparti entre les différents secteurs du camp retranché pour leur défense
propre.
Malheureusement, la portée de ces pièces varie
entre 5 et 9 kilomètres, tandis que certaines batteries allemandes tireront de
14 kilomètres de distance, ce qui leur permettra de se tenir à l'abri des obus
français.
Le nombre total
de coups à tirer par l'artillerie de la défense s'élève à 250000
Le personnel
consiste en vingt-six batteries a pied, dont huit qui proviennent de Cherbourg
et de Brest.
La cavalerie
est représentée par deux
escadrons de réserve du 6e chasseurs.
Le génie
comprend sept compagnies.
Un colombier
militaire assure la liaison avec Paris et Reims. Le service aéronautique est
réduit à rien : deux dirigeables qui étaient à Maubeuge et tous les avions
jusque là disponibles, quittent la place, après Charleroi.
Il ne reste
dans le camp retranché qu'un ballon captif qui sera rapidement détruit, et un
vieil avion très endommagé qu'un officier, le lieutenant d'artillerie Leliévre
(d'une batterie de côte venue de Brest), remettra tant bien que mal en état,
mais qui sera vite hors d'usage sans avoir pu rendre de services sérieux.
Des hôpitaux
sont organisés dans la ville :Ils pourront recevoir jusqu'à 3.000 blessés.
L'Intendance a
constitué des approvisionnements très importants, qui suffiraient au moins pour
un siège de trois mois.
Les troupes et
les services représentent un effectif total un peu supérieur à 49000
rationnaires, y compris un millier d'officiers. En dehors du gouverneur, il y a
trois généraux dans la place : les généraux Vinckel Mayer, Ville et Peyrecave
à l'ouest du chemin de fer de Mons jusqu'à la
Sambre. il est tenu par quatre bataillons territoriaux ; un bataillon du 32e
colonial reste en réserve à Douzies.
2e
secteur (colonel
Guérardel)
au sud ouest de
Maubeuge, de la Sambre à la Solre.
Cinq bataillons
et demi de territoriaux en assurent
3e
secteur (colonel de La
Motte),
de la Solre à l'ouvrage du Fagnet. Sa garnison
consiste en cinq bataillons et demi de territoriaux, un bataillon de douaniers.
4e
secteur (général Ville)
de l'ouvrage du
Fagnet jusqu'à Héronfontaine exclus. I1 est également défendu par cinq
bataillons de territoriaux et un bataillon de douaniers.
5e
secteur (colonel
Cambier), d'Héronfontaine au chemin de fer de Mons.
N'y sont
affectés qu'un seul bataillon territorial, un bataillon et une compagnie de
marche, tirés du dépôt du 145e. La garnison du noyau central est
formée d'un bataillon de marche (provenant du même dépôt)
La réserve
mobile comprend, sous les ordres du général Vinckel Meyer, tout le reste des
éléments actifs et de réserve, à savoir
Jusqu’à la mi-août, la population de Maubeuge n'a pas manifesté une grande anxiété.
L'afflux des
troupes qui arrivent dans le camp retranché contribue d'ailleurs à donner à la
ville une physionomie très animée, bruyante, presque joyeuse.
Les cafés ne
désemplissent pas ; chacun vient reconnaître des amis, des camarades
d'autrefois, que la mobilisation appelle dans la place.
Les gens
échangent leurs impressions; on fait des plans de campagne, ou plutôt des plans
de victoire. La masse de la population doute de l'éventualité d'un siège. Les
Allemands se battent encore à Liége; ils sont loin delà frontière française.
Ceux qui
craignent l'approche de l'ennemi sont généralement taxés de pessimisme, et vite
pris dans la fièvre générale, étourdis par l'animation de la foule, ils
oublient leurs soucis d'un instant.
Mais le 15 août, brusquement, une véritable angoisse s'empare de la population.
Quelques
Belges, qui se retiraient en toute hâte devant l'invasion, sont venus annoncer
les progrès des Allemands. Ils racontent que le massacre et l'incendie accompagnent
l'envahisseur.
Comme pour
corroborer les dires des fugitifs, la voix du canon se fait entendre dans
l'est.
Chacun, le cœur
palpitant, écoute ces détonations, qui éclatent là bas, dans la direction de la
vallée de la Meuse.
Vers le soir,
les nouvelles se précisent : les Allemands ont forcé le passage du fleuve à
Dinant et se sont emparés de la ville; ils se rapprochent.
L'inquiétude
augmente.
Quelques heures
plus tard, on annonce que les soldats du 1e corps d'Armée, dans une brillante
contre-attaque, ont rejeté l'adversaire au delà de la, Meuse : Ce succès est
transformé en grosse victoire; aussitôt, c'est une joyeuse animation qui
s'empare de Maubeuge.
Les Allemands continuent de progresser en Belgique; ils entrent à Louvain, à Bruxelles. Leur marche semble devoir les conduire droit vers Maubeuge et Lille.
L'armée
française est encore loin... où pourra t elle intervenir ?
Et les Anglais,
dont on annonce le débarquement en France, et qui sont impatiemment attendus ?
Une mesure
indispensable, prise par le gouverneur, contribue à semer l'inquiétude: sur les
murs de la ville, on appose des affiches qui prescrivent à la population
civile, en prévision d'un siège, de quitter la place.
Aussitôt,
beaucoup S'affolent; les départs se précipitent. En quelques jours, 25000
personnes abandonnent Maubeuge : elles ne savent souvent où aller.
Beaucoup ne
pourront se résoudre à laisser leurs foyers déserts, et malgré toutes les
mesures prises, elles reviendront sur leurs pas, avant l'investissement.
L'arrivée
d'avions britanniques, puis, le 22 août, le passage d'un régiment écossais
suscitent encore un certain enthousiasme. Mais celui ci s'éteint bien vite, car
les progrès des Allemands se précisent
L’Armée von
Kluck arrive vers Mons; l'Armée Bülow franchit la Sambre à Charleroi.
Depuis le 17
août, la garnison de Maubeuge est placée sous le commandement du général
Lanrezac, qui dirige la 5` Armée.
Le général
songe un instant à faire appel au 145e, au 345e, aux 31e et 32e
coloniaux pour renforcer les effectifs dont il dispose, â, la veille d'une
grosse bataille.
Mais il se rend
compte de la nécessité de laisser au Gouverneur tous ses moyens en hommes pour
compléter à la hâte l'organisation d'une Place gui peut se trouver d'un jour à
l'autre sous le feu des canons ennemis.
Les 22 et 23 août, une furieuse bataille s'engage de part et d'autre de la Sambre; au sud de Charleroi entre la 5e Armée française et la I Ie Armée allemande ; à Mons, entre les Anglais et les troupes de von Kluck.
Le soir du 23, nos troupes de campagne battent en retraite.
Le général
Lanrezac fait connaître au général Fournier que « la 5e Armée se replie en
direction générale de Chimay Aubenton, et qu'il appartient au Gouverneur de
Maubeuge « de prendre toutes dispositions utiles pour la défense de la Place »
Le général Lanrezac ne veut pas ,emmener avec lui les régiments actifs et de réserve de Maubeuge pour les joindre à ses troupes, car il estime que ce serait affaiblir dangereusement la garnison.
Le général Fournier se trouve livré à lui même. A quelle décision va t il se résoudre ?
Aux termes des instructions ministérielles de 1910 le rôle de Maubeuge consiste à appuyer les manœuvres d'une Armée de campagne. « La résistance de la Place n'a pas de raisons pour se prolonger isolément. »
Telle était la
conception au temps où l'on croyait que Maubeuge n'aurait â, subir qu'un siège
de peu de durée, dés le début des hostilités, et serait rapidement secourue par
nos forces de campagne, sitôt après leur concentration.
Les
circonstances sont tout autres le 23 août 1914
Maubeuge, qui n'a pas servi de pivot de manœuvre dans la bataille de Mons Charleroi, est maintenant presque isolée; nos armées de campagne, battues, se retirent vers le sud ouest.
Le général
Fournier doit il prescrire l'évacuation immédiate de la garnison et se lier à
la retraite de la 5° Armée?
Il considère que s'il a été nommé au poste de donner la ville, mais pour en assurer la défense.
Il se décide donc à résister jusqu'au bout, coûte que coûte.
Les Allemands poursuivaient leur marche en avant sans se laisser retarder par Maubeuge.
Ils laissent
seulement en arrière un corps de siège, à l'effectif de 40000 hommes environ, sous les ordres du général Zwehl
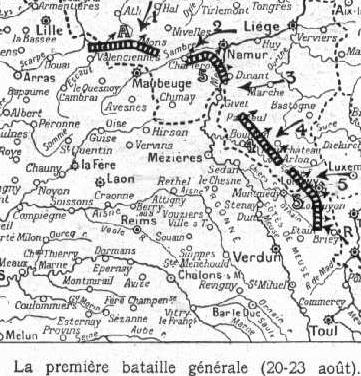 Autant que les
renseignements actuels permettent de l'affirmer, ce corps de siège ne comprend
que le VIIe corps de réserve, la 26e brigade du VII` corps actif et un
groupement de grosse artillerie (aux ordres du général lieutenant Steinmetz).
Un certain nombre de
Autant que les
renseignements actuels permettent de l'affirmer, ce corps de siège ne comprend
que le VIIe corps de réserve, la 26e brigade du VII` corps actif et un
groupement de grosse artillerie (aux ordres du général lieutenant Steinmetz).
Un certain nombre de
Les Allemands
se tiennent d'abord assez loin de Maubeuge; ils se contentent de couvrir le
déploiement de leur artillerie lourde, sans se risquer, avec des effectifs
relativement faibles, dans une attaque brusquée contre le Camp Retranché.
Sur tout le
pourtour de celui ci, les détachements ennemis s'étendent, précédés de
cavalerie, et coupent peu à peu les communications de Maubeuge avec
l'extérieur; ils s'établissent ensuite en observation, face à la ville.
Le général
Fournier, sur l'ordre du général Joffre et du général Lanrezac, prescrit la
destruction des voies ferrées, en vue d'entraver le ravitaillement des armées
ennemies.
C'est ainsi que
des détachements du génie font sauter les ponts de Jeumont, de Berlaimont et de
Fourmies.
De plus, du 24 au 28 août, le général Fournier, qui a reçu de ses agents secrets des renseignements sur la progression allemande et qui se voit peu à peu privé de toutes ses liaisons avec le cœur du pays, se préoccupe de pousser des reconnaissance en dehors du périmètre de la place : il veut se rendre compte des intentions du Commandement ennemi, inquiéter le corps de siège, et, en même temps, aguerrir ses propres troupes.
Une première
reconnaissance a lieu le 25 août, au nord de Maubeuge, vers Quévy et Havay.
Toute la réserve générale y participe. Au cours de cette opération, le génie opère des destructions sur la voie ferrée étroite qui longe la frontière belge. Quelques engagements de patrouilles se produisent : dans un de ces combats, le prince de Saxe Meiningen est mortellement blessé par un cavalier du 6e chasseurs.
Le lendemain 26 août, une nouvelle sortie a lieu sur La Longueville pour reconnaître des forces ennemies qui ont été signalées dans cette région seuls, le 145e régiment d'infanterie, deux batteries de 75 et un escadron y prennent part.
Tout comme la
veille, la journée n'est marquée que par des combats insignifiants contre de
fortes patrouilles ennemies, qui se dérobent.
Vers le soir du
26, l'attention de la Place est fortement surexcitée : une canonnade lointaine
roule dans l'ouest; durant deux jours, on percevra encore ses échos; puis le
bruit de la bataille s'éteindra peu à
peu, et on devra renoncer à voir les armées alliées réapparaître sous les murs
de la ville.
Depuis le 27 août, le général Fournier, a déclaré Maubeuge investie. L'artillerie de la Place commence à exécuter des tirs fréquents sur des objectifs assez variables localités, croisements de routes... En général, ces tirs sont dirigés un peu au hasard et ne donnent que de très faibles résultats.
Par contre, ils
offrent l'inconvénient de faire repérer successivement chacune de nos batteries
L’ennemi se
garde bien de laisser perdre les renseignements que la défense lui fournit
ainsi.
Le 28 août, une troisième reconnaissance a lieu, vers
le sud cette fois. Un petit combat s'engage, au delà du bois Leroy, mais pas
plus que les précédents, il ne permet à la réserve générale de se rendre compte
de la situation de l'adversaire.
Aucune de ces
reconnaissances n'a été poussée assez loin; et surtout aucune d'entre elles n'a
été dirigée dans le secteur est, où se prépare contre Maubeuge une formidable
menace
A cette date du
28 août, l'artillerie allemande a, en effet, achevé son déploiement.
Elle a pris
position vers Solre sur Sambre, Peissant, Fauroeulx, Haulchies, Givry, entre la
Sambre et la Trouille.
L'infanterie,
dans ce secteur, s'est établie avec ses gros sur le ruisseau de Grand Reng et
vers Erquelines, pour couvrir les batteries de siège.
Brusquement, le 29 août, à 13 heures, le bombardement se déclenche : les obus tombent sans interruption sur Le Boussois, le Fagnet, La Salmagne et Bersillies.
Avant d'étudier
les effets du bombardement, il est nécessaire de signaler que les Allemands
disposent, à l'intérieur de la Place, de tout un système d'espionnage ; ce
dernier va leur fournir les plus précieux renseignements, et leur permettre de
diriger leur tir sur les objectifs principaux.
Le
commandant Cassou raconte :
« Au centre
de résistance du Boussois, un paysan revêtu d'une énorme blouse suivait avec intérêt
toutes les phases de la lutte. Sa présence continuelle éveilla nos soupçons; on
le vit s'arrêter derrière une haie et lâcher un pigeon voyageur. Arrêté
immédiatement, il fut fouillé; on le trouva possesseur d'autres pigeons cachés
sous sa blouse. Il avoua qu'il était un espion: il fut fusillé... On découvrit
un fil téléphonique souterrain, reliant Maubeuge à Jeumont, dans une usine dont
le directeur était allemand, et qui fournissait par un conduit souterrain la
force électrique à Maubeuge »
Ces derniers ne
se contenteront pas d'envoyer des renseignements à l'ennemi ; ils
s'efforceront, par des propos habilement répandus, de semer la panique dans la
ville.
Un malheureux
incident leur fournira le prétexte d'accuser le Gouverneur de faiblesse,
d'incapacité, voire même de trahison.
Le général
Fournier avait, au début d'août, adressé au Ministre de la Guerre un télégramme
lui rendant compte de l'état lamentable de Maubeuge et de l'impossibilité de
résister longtemps en cas d'attaque.
Très ému de ce
message, craignant que le Gouverneur ne fût au-dessous de sa tâche, M. Messimy
avait envoyé dans la Place le général Pau pour se rendre compte de la
situation, et prendre, au besoin, des mesures extrêmes contre le général
Fournier.
L'enquête avait
été tout à l'éloge de ce dernier, et le général Pau avait même cru nécessaire
de réclamer « les trois étoiles pour le
Gouverneur. Mais M. Messimy n'avait pas attendu ces rapports; et, dés le 8
août, par décret ministériel, il révoquait de ses fonctions le général
Fournier.
On juge de
l'effet produit à Maubeuge, lors de la lecture de l'Officiel. Au retour à Paris
du général Pau, M. Messimy, renseigné, envoyait au Gouverneur ses félicitations
pour le zèle qu'il avait déployé dans l'organisation de la Place et le
rétablissait dans ses fonctions. Le décret nouveau paraissait également dans un
numéro de l'Officiel; mais celui ci n'arrivait jamais à Maubeuge, en raison des
événements militaires.
Jusqu'à la reddition, le siège de Maubeuge consistera plutôt dans une action d'artillerie. L'infanterie du VIIe corps allemand de réserve se contentera généralement d'occuper le terrain que les troupes de la défense auront évacué, à la suite des effets destructeurs du feu.
Le bombardement
aurait pu être retardé d'un jour ou deux, si les Français avaient occupé des
positions avancées dans le secteur est du camp retranché.
Mais le général
Fournier a évité, peut être à tort, de prendre cette mesure, par crainte
d'élargir le périmètre de la Place qu'il défend avec des effectifs déjà
insuffisants, et d'aventurer hors de la zone principale des troupes non
aguerries, généralement fort peu instruites. Il redoute que celles ci ne soient
bousculées dés le premier choc, et que l'ennemi ne réalise, à cette occasion,
une avance importante en direction de Maubeuge
Dirigé le 29
août, le bombardement, sur le secteur de la zone principale : Le Boussois La
Salmagne, gagne peu à peu en largeur et en profondeur. Les canons allemands
arrosent le fort de Cerfontaine aussi bien que l'ouvrage des Saris; les plus
gros calibres (210,280,305, puis 420 à partir du 2 septembre) prennent part à
l'action.
Maubeuge
elle-même reçoit des obus de 12 centimètres; le quartier de la Porte de France
est particulièrement éprouvé; des incendies se déclarent; leurs ravages sont
considérables dans la rue de France. Les pompiers, sans cesse au travail,
malgré la pluie des projectiles, subissent des pertes très sérieuses. Par
contre, la population réfugiée dans les caves, ne souffre pas beaucoup du
bombardement. Le tir de l'artillerie ennemie se fait très précis, toujours en raison
des renseignements fournis par les espions aux troupes de von Zwehl.
Le faubourg de
Sous le Bois, occupé par la réserve générale, est particulièrement repéré, de
même que le faubourg de Louvroil, où les cantonnements sont nombreux.
Les conduites
d'eau et de gaz sont coupées ; Les liaisons télégraphiques et téléphoniques
toutes aériennes rompues.
Dans la zone
principale, les effets du bombardement sont encore plus considérables.
Les ouvrages
permanents et les ouvrages de circonstance sont transformés en véritables nids
à obus : aucune casemate ne peut résister ; les abris bétonnés des ouvrages
d'infanterie sont fissurés ; une perpétuelle menace plane sur ceux qui s'y
réfugient : les gaz, dégagés par les explosions, s'y sont accumulés et
produisent de rapides asphyxies.
Le fort du
Boussois est ravagé par les obus; la tourelle Mougin est décalottée; les pièces
à l'air libre, prévues pour le flanquement des intervalles, sont détruites ; Le
magasin à poudre où une section s'est abrités, est crevé par un 305 autrichien
: Les murs s'effondent et soixante français meurent assommés où asphyxiés.
En vain, le
Gouverneur essaye de combattre l'artillerie ennemie. A défaut des canons des
secteurs non attaqués, qu'il ne peut faire transporter, faute de moyens et de
temps suffisants, il envoie entre Cerfontaine et les Sarts, des batteries de la
réserve. Mais nos pièces sont mises successivement hors d'usage.
Les troupes de
première ligne (des territoriaux ) sont épouvantées par les effets insoupçonnés
d'un bombardement semblable.
Certaines
unités sont prises de panique.
Le commandant
du fort du Boussois se fait évacuer pour troubles nerveux, à la suite de
l'explosion d'un obus.
Dans la nuit, privée
de son chef, la garnison lâche pied et se reporte précipitamment jusque dans
Maubeuge.
Des fugitifs
annoncent même que Le Boussois a été pris par les Allemands.
La situation
créée par cet incident est très grave : si l'ennemi s'est emparé où s'empare du
fort, toute la position principale se trouve compromise. La place tombera en
peu de jours.
Le Gouverneur
porte aussitôt un bataillon
du 145e dans le secteur
menacé. Les Allemands ne se sont heureusement pas aperçus de l'évacuation du
Boussois.
Avec cette
unité, le capitaine Thabar réoccupe Le Boussois.
Les
circonstances sont telles, qu'il faut, à tout prix connaître les emplacements
des batteries allemandes afin de pouvoir les contrebattre. Des renseignements
erronés, fournis parles habitants, annoncent au général Fournier, le 1e
septembre au matin, que l'artillerie ennemie a pris position dans les sablières
d'Erquelines, et immédiatement en arrière des villages de Grand Reng, Vieux
Reng, Rouveroy.
Aussitôt, le
gouverneur organise une grosse sortie pour tenter la destruction des batteries
adverses.
Toute la
réserve générale doit participer à cette opération. Mais les circonstances
paraissent si pressantes que le Commandement n'a pas le temps de prendre les
mesures capables d'assurer une parfaite liaison entre les batteries de place et
l'infanterie.
Un fait plus
grave contribuera à l'échec de la sortie : Le commandant de la réserve générale
se contente de transmettre à ses troupes les ordres du Gouverneur, sans assurer
la direction de l'attaque.
Dés lors, les
différentes unités d'infanterie, mal soutenues déjà par l'artillerie, vont agir
sans aucune liaison entre elles.
Pendant que
deux bataillons territoriaux couvrent les flancs de la réserve générale, d'une
part en direction de Villers Sire Nicole, d'autre part au sud de la Sambre, en
direction de la ferme Watissart, deux colonnes se portent au centre, l'une vers
Vieux Reng, l'autre vers les sablières d'Erquelines.
A la première
colonne, le 31e
colonial se lance en avant à
une allure très rapide, malgré les effets d'un feu d'enfer déclenché par toutes
les batteries allemandes (aussi bien par les batteries de siège que par les
batteries de campagne)
Il aborde déjà
les lisières de Vieux Reng. Mais le régiment est tout entier déployé ; les
unités de renfort sont venues se fondre dans la première ligne décimée.
Les coloniaux
sont incapables d'emporter le village. Ils sont cloués sur place par le tir des
mitrailleuses ennemies, installées dans les maisons.
Les Allemands
accourent de toutes parts, pour défendre le secteur menacé.
A bout
d'efforts, les marsouins reculent.
A ce moment
seulement, le 345e, placé plus en arrière, intervient : il
est trop tard. Le défaut de direction amène un repli général de la gauche
française.
La colonne de
droite n'a pas été plus heureuse le 145e n'a pu
dépasser la route Vieux Reng Marpent.
A y heures, sur
tout le front, les chefs des différentes colonnes ordonnent la retraite; et la
réserve générale se reporte sous les murs de Maubeuge
Après ce
sanglant insuccès, la Place devra subir son destin.
Le feu des
Allemands, qui s'était un instant retourné contre les troupes de la réserve
générale, reprend contre la ligne principale de défense et contre la ville de
Maubeuge.
Un bombardement
infernal s'abat sur les ouvrages du 3e secteur, depuis Cerfontaine jusqu'à la
Sambre. Au fort de Cerfontaine, en particulier, un obus de 420 traverse les voûtes
en maçonnerie après avoir percé le revêtement de terre. Il éclate dans une
casemate où une soixantaine d'hommes se sont réfugiés. Tout comme au Boussois,
quelques jours plus tôt, il n'y a pas un soldat qui échappe parmi les occupants
de la casemate.
Ceux qui ne
sont pas écrasés par les blocs de pierre sont asphyxiés par les gaz provenant
de la déflagration de la poudre.
Deux
ans plus tard seulement, en 1916, les corps de ces infortunés pourront être
dégagés des décombres et recevoir la sépulture.
L'action de
l'artillerie allemande n'est pas moins puissante sur le front Boussois La
Salmagne.
Les batteries,
les ouvrages d'infanterie deviennent bientôt intenables; le général Fournier
donne l'ordre de les évacuer durant le bombardement pour chercher un refuge
dans les tranchées moins repérées, creusées dans les intervalles.
Les Allemands
lancent leurs fantassins à l'attaque; il semble que les troupes françaises,
engagées sur la ligne principale de résistance, pourront difficilement tenir:
elles sont trop éprouvées moralement et physiquement.
Aussi, le
Gouverneur prescrit il, le 2 septembre, de reporter sur la position de soutien
la plus grande partie des batteries de la première ligne.
Au sud de la
Sambre, il fait garnir d'artillerie le bois des Bons Pères pour prendre
éventuellement sous son feu un ennemi qui aurait pris pied entre Le Boussois et
Le Fagnet, et s'avancerait en direction de Maubeuge.
De même les
batteries de la réserve d'artillerie et celles de l'ouvrage des Épinettes
doivent s'installer au sud d'Élesmes, en prévision de la lutte qui peut
s'engager d'un instant à l'autre en avant de la ligne de soutien.
En fait, le
temps et les moyens manqueront pour reporter sur ses nouvelles positions l'artillerie
de la zone principale.
La situation
s'aggrave encore; le moral des troupes engagées fléchit visiblement, sous la
violence du feu.
Persuadé que l'ennemi
va passer bientôt à une grosse attaque au nord de la Sambre, et qu'il
entreprendra en même temps une action secondaire au sud de la rivière, entre
Rocq et Cerfontaine, le Gouverneur se préoccupe d'assurer l'unité de direction
dans chacune des zones menacées : il élargit le secteur du général Ville, en
l'étendant à droite, jusqu'à la Sambre.
Le général
Fournier est conduit, peu après, à agrandir aussi ce secteur
Le général
Ville aura sous ses ordres toutes les troupes établies entre Héronfontaine et
le chemin de fer de Mons.
Il reçoit
également la libre disposition de la réserve générale. Le Gouverneur espère que
les unités d'active et de réserve réussiront à étayer les territoriaux épuisés.
Le général
Ville s'établit au carrefour d'Assevent pour diriger la défense.
Sa mission sera
lourde à remplir; il devra tout faire par lui même, car il n'a pas d'état major
à sa disposition, mais seulement un officier d'ordonnance.
Et cependant il
va falloir à tout prix tenir, gagner du temps. Maubeuge a un rôle à remplir. La
Place maintient au tour d'elle
40000 Allemands
Si elle tombe
trop tôt, ces forces ennemies pourront se reporter contre les troupes de
campagne françaises, et peut être, par leur intervention en un moment critique,
décider du sort de la guerre.
Le général
Fournier est décidé à résister coûte que coûte
L’attaque d'infanterie.
Déjà, des
détachements ennemis se sont approchés des ouvrages de la Salmagne, et du Fagnet.
Reçus à coups de canon et à coups de fusil, ils se sont repliés vers Vieux Reng
et Grand Reng, en annonçant que la résistance des Français n'était pas encore
brisée.
La violence du
tir déclenché par l'artillerie allemande s'est encore accrue; du fort des Sarts
au Boussois une grêle d'obus s'abat sur nos positions; nos troupes plient sous
la violence du feu ; des défaillances se produisent.
Au fort des
Sarts, dans la matinée du 4, la garnison a fait bonne contenance sous un
bombardement de 150 mais à partir de 13h30, des 420 arrivent sur l'ouvrage,
percent les minces revêtements de terre argileuse, épais de 0.5 m seulement,
défoncent les casemates. Vers 15 heures, la majeure partie de la garnison
évacue précipitamment l'ouvrage et s'éloigne dans la direction de Maubeuge.
Le soir, le
fort est abandonné par ses derniers occupants.
Nos soldats
continuent à tenir dans le reste du point d'appui des Sarts.
Le personnel de
nombreuses batteries abandonne ses pièces sur le terrain sans les détruire,
faute d'explosifs : on se contente d'emporter les culasses.
L'ennemi occupe
l'ouvrage du Fagnet, dont la garnison s'est retirée un peu rapidement.
Par contre, la
résistance est très vive au point d'appui de La Salmagne.
Dans l'ouvrage
principal, le capitaine Eliet lutte désespérément pour arrêter l'adversaire qui
débouche de Vieux Reng et de Grand Reng; il réussit à briser sur son front les
assauts des Allemands. Mais ces derniers parviennent à s'installer dans la
ferme de la Salmagne.
Plus au sud,
contre Le Boussois, tous les efforts sont vains
La zone principale se trouve néanmoins
entamée; le général Fournier comprend que, dés lors, les événements vont se
précipiter.
Dans la
soirée, il réunit le Conseil de défense pour lui poser la question suivante :
« Vaut il mieux résister jusqu'au bout dans
Maubeuge, ou tenter de se faire jour à travers le cercle d'investissement dans la
direction du Quesnoy Arras, pour tenter de regagner les lignes françaises ?
»
Mais les
membres du Conseil sont unanimes à préconiser la résistance.
Toutefois,
certaines mesures paraissent nécessaires pour le cas d'une catastrophe ; c'est
ainsi que les neuf drapeaux de la garnison sont réunis, le 5 au soir, à la
caserne Joyeuse : ils y seront brûlés le lendemain matin.
Le bombardement continue avec la même
violence; le colonel Viard, qui commande le centre de résistance de Bersillies
La Salmagne, se voit contraint d'en prescrire l'évacuation : il ne maintient
ses troupes que dans l'ouvrage de La Salmagne.
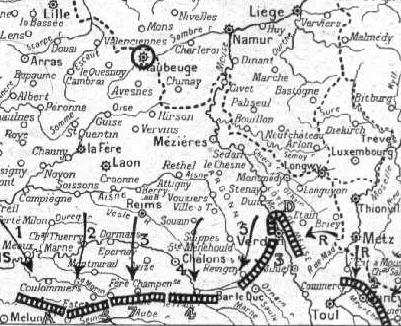 Au soir du 5 septembre, la plus grande
partie de la zone principale du secteur n° 4 est tombée aux mains des
Allemands. Le général Ville organise la défense de la position de soutien
Elesme Mairieux. En arrière, il rallie toutes les troupes qui évacuent la
position principale ; il porte à Asseyent le 31e colonial
qui vient relever le 145e épuisé. Ce
dernier est ensuite placé en troisième ligne, à Pont Allant.
Au soir du 5 septembre, la plus grande
partie de la zone principale du secteur n° 4 est tombée aux mains des
Allemands. Le général Ville organise la défense de la position de soutien
Elesme Mairieux. En arrière, il rallie toutes les troupes qui évacuent la
position principale ; il porte à Asseyent le 31e colonial
qui vient relever le 145e épuisé. Ce
dernier est ensuite placé en troisième ligne, à Pont Allant.
Sur la rive sud
de la Sambre,ennemi venant du nord prend pied dans Recquignies; il déborde par l'ouest
les batteries de Rocq : la garnison, déjà menacée de front, doit se
replier,sous peine d'être encerclée ; elle n'a que le temps de faire saute:la
poudrière pour ne pas laisser ses stocks de munitions tomber aux mains de
l'ennemi.
Ses bataillons
semblent à bout de résistance : il rompt délibérément le contact pour tenter de
remettre un peu d'ordre parmi ses troupes dés qu'elles ne seront plus aux
prises avec les Allemands. Il occupe une position qui s'étend du carrefour de Mons, par le hameau et le
bois des Sarts, jusqu'à l'ouvrage d'Héronfontaine.
L'ennemi l'arrose copieusement d'obus : tout
le quartier de la Porte de France commence à flamber. Soirée tragique où se
mêle, au fracas des bombes, le crépitement de la fusil Jade, pendant qu'au
centre du front de bataille juste au‑dessus de la cité, de grandes
flammes montent vers le ciel, comme pour éclairer l'agonie de Maubeuge En
arrière des positions françaises, de longues colonnes se pressent,
s'entremêlent; des cris de douleur et de rage s'échappent de cette multitude où
sont épars les civils qui abandonnent leurs habitations ravagées par le
bombardement, et de malheureux soldats qui oublient où le devoir les appelle,
qui ne pensent plus qu'à fuir, n'importe où, mais loin des obus dont les
détonations les poursuivent encore.
Le Gouverneur
est resté dans Maubeuge : très sombre, il attend que le sort de la Place
s'accomplisse. Les nouvelles qui arrivent sont de plus en plus navrantes. A 18
heures, l'ennemi s'est emparé de la moitié du Camp Retranché.
Le général
Fournier convoque le Conseil de défense, pour le consulter (selon les termes du
règlement) « sur les moyens de prolonger le siège ».
Une gerbe de
flammes prodigieuse, une énorme explosion qui ébranle le sol à trois kilomètres
à la ronde, une pluie de cendres qui retombe : c'est fini, l'arsenal n'est plus
qu'un monceau de ruines.
Le bombardement atteint une
effrayante intensité.
Les deux
batteries de 75, en position pris du petit bois de Douzies, se tiennent prêtes
â, intervenir; Les canons du fort Leveau doivent flanquer l'ensemble de nos
positions sur la rive gauche de la Sambre.
Le tir dure jusqu'à
11 heures, moment où Héronfontaine est évacué. L'infanterie allemande
s'infiltre par tous les plis du terrain; elle pénètre dans le bois des Sarts,
prend à revers les défenseurs de l'ouvrage : les Français doivent se retirer
vers l'ouest. Les gros canons des assiégeants concentrent maintenant leurs feux
sur le fort Leveau.
Une demi heure
de bombardement suffit pour ruiner la position et obliger nos soldats à
l'évacuer.
Le général
Ville a son centre entièrement découvert. Il voit avec angoisse s'approcher le
moment critique de l'assaut allemand.
Toutes ces
graves nouvelles parviennent successivement au général Fournier.
On l'informe
que son infanterie est diminuée de moitié, qu'il n'y a plus d'artillerie pour
la soutenir, que le moral du soldat est brisé, que tous les forts (â
l'exception d'Hautmont) sont successivement écrasés.
On serait
rejeté immédiatement sur Hautmont, où s'entassent maintenant 40000 fuyards.
Dés lors, le
général Fournier « se voit contraint de recourir aux négociations pour prolonger
la durée de résistance de la Place jusqu'au 8 septembre au soir, si possible
» 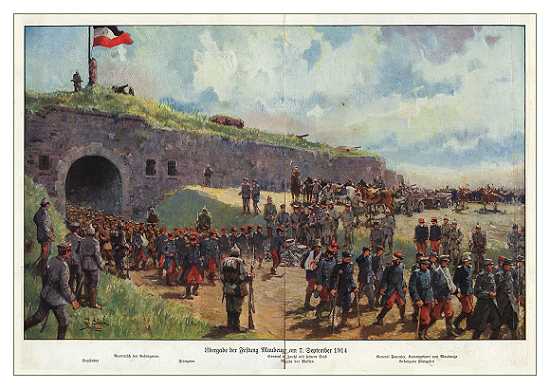
Maubeuge,
7 septembre 1914
Je vous
demande un armistice de 24 heures pour enterrer les morts et discuter de la
reddition de la Place.
En même temps
qu'il envoyait au général von Zwehl le capitaine Grenier, le général Fournier
faisait hisser le drapeau blanc sur le clocher de Maubeuge. Le général
PeyreCave fit répéter partout ce signal dans le 1e secteur.
Resté presque
seul prés de Douzies, le général Ville voit les troupes allemandes se
rapprocher à deus ou trois cents mètres. Lui aussi, il croit la capitulation
signée ou prés d'être signée ; il fait suspendre le feu.
Et quand le
général ennemi Neuhauss, à la tête d'éléments de cavalerie, surgit et veut le
faire prisonnier, le général Ville proteste, déclare que le Gouverneur achève
de négocier; il montre le drapeau blanc qui flotte sur Maubeuge.
L'allemand conclut
alors avec le Français une convention aux termes de laquelle les troupes
adverses resteront sur place de part et d'autre de la route Douzies Hautmont.
Quelques
minutes plus tard, un parlementaire ennemi vient informer le général Ville que
le général de division von Harbou veut le voir.
Ainsi finit
cette bataille de sept jours, engagée depuis le 29 août dans le 4e secteur, et
qui, selon les termes du général Fournier,
Beaucoup des nôtres se retournent encore : Ils veulent apercevoir une dernière fois la ville qu'ils n'ont pu sauver ; puis ils continuent leur marche douloureuse vers le nord, vers la Belgique, vers les prisons d'Allemagne qui se refermeront sur eux durant plus de quatre années.
Mais tous, jeunes soldats de l'active ou de la réserve, ou vieux troupiers de la territoriale, veulent espérer encore.
Les Allemands de von Zwehl vont pouvoir se lancer à marches forcées vers le sud. Mais maintenant ils arriveront trop tard pour décider du sort de la bataille qui s'engage.
On dirait que les nôtres entendent gronder tout là-bas, sur la Marne, les canons, de leurs frères d'armes ; On dirait qu'ils sentent prochaine la première défaite allemande.
Texte tiré de « La grande guerre vécue, racontée,
illustrée par les Combattants, en 2 tomes.
Aristide Quillet, 1922 »
Voir
l'historique du 145e qui a participé à cette bataille
Voir les combats des 3 et 4ème armées pendant la même
période
Voir
les combats de la 5ème armée pendant la même période
Voir
les combats des 1 et 2ème armées pendant la même période
![]()
Suite des Opérations : La Marne
Retour accueil retour page précédente
